Kronstadt 1921 : prolétariat contre bolchevisme
Une coïncidence de dates a voulu que le 18 mars soit
le premier jour de la Commune de Paris et aussi le
dernier jour de la Commune de Kronstadt. Si le 25 octobre
1917 consacre la chute, par un coup d’État militaire,
du gouvernement « modéré » et bourgeois de Kerensky,
il y a bien eu, précédemment une véritable révolution
sociale.
Durant les mois qui précèdent, les soviets (ou Conseils
de délégués ouvriers, soldats et paysans) avaient pénétré
dans presque toutes les usines, sapant les bases économiques
et sociales du régime bourgeois. Les comités et soviets
de soldats avaient totalement désorganisé l’armée
tsariste. Dans les campagnes, les paysans avaient exproprié
collectivement les propriétaires terriens et avaient
entrepris la culture commune de la terre. Pendant l’Octobre
des ouvriers et des paysans, les slogans étaient sans
ambiguïté : « La terre aux paysans, l’usine à
l’ouvrier », « Le pouvoir aux soviets locaux et
au centre des soldats, ouvriers et paysans ».
La Contre-révolution bolcheviste
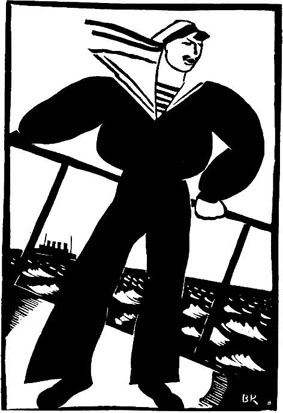 Trois tendances inconciliables vont s’affronter
: Il y avait le camp de la Réaction avec les « armées
blanches » qui tentait de réinstaurer le tsarisme ;
le camp des partisans d’une société dirigée sur
tous les plans par un « État ouvrier » ; et il y avait
aussi (et surtout) un mouvement populaire, porteur
d’une dynamique et d’un projet autogestionnaire.
L’Histoire va alors démontrer qu’entre autogestion
sociale et étatisation, il n’y avait pas d’accord
possible. Dès leur arrivée au pouvoir les bolcheviks
vont mettre en œuvre leur fameuse conception de
la « dictature du prolétariat » qui, bien évidemment,
ne signifie pas autre chose que la dictature du Parti
: « La dictature de la classe ouvrière ne peut être
garantie que sous la forme de la dictature de son avant-garde,
c’est-à-dire du Parti communiste » (Résolution
du XIIe Congrès du Parti).
Trois tendances inconciliables vont s’affronter
: Il y avait le camp de la Réaction avec les « armées
blanches » qui tentait de réinstaurer le tsarisme ;
le camp des partisans d’une société dirigée sur
tous les plans par un « État ouvrier » ; et il y avait
aussi (et surtout) un mouvement populaire, porteur
d’une dynamique et d’un projet autogestionnaire.
L’Histoire va alors démontrer qu’entre autogestion
sociale et étatisation, il n’y avait pas d’accord
possible. Dès leur arrivée au pouvoir les bolcheviks
vont mettre en œuvre leur fameuse conception de
la « dictature du prolétariat » qui, bien évidemment,
ne signifie pas autre chose que la dictature du Parti
: « La dictature de la classe ouvrière ne peut être
garantie que sous la forme de la dictature de son avant-garde,
c’est-à-dire du Parti communiste » (Résolution
du XIIe Congrès du Parti).
Les organisations ouvrières sont mises au pas. En avril
1918, tous les clubs anarchistes à Moscou sont fermés
(pris au canon) et 600 militants libertaires sont jetés
en prison.
Le nouveau pouvoir va imposer une militarisation du
travail et transformer des millions d’individus
en exécutants soumis.
Militarisation du travail et fascisme rouge
Le renforcement de la discipline et la présence de
l’armée à l’intérieur même des usines va
provoquer de nombreux meetings de protestation. Les
organisateurs de ces meetings seront dénoncés comme
des « contre-révolutionnaires », des saboteurs, des
espions etc.
Pour Lénine et les bolcheviks les paysans sont incapables
d’une prise de conscience révolutionnaire, et
doivent donc être asservis à « l’État prolétarien
». C’est ainsi que l’Armée rouge va organiser
un pillage systématique des campagnes, créant artificiellement
le conflit « ville-campagne ». Au lieu de faire alliance
avec la paysannerie, qui combat le retour des Blancs
(tsaristes), et de respecter le slogan « La terre aux
paysans, l’usine à l’ouvrier », le parti
bolchevik déclenche l’hostilité générale de la
paysannerie à son égard. Une fois le danger contre-révolutionnaire
écarté, des révoltes armées embrasent le pays tout
entier (dont le mouvement anarchiste makhnoviste).
En février 1921, soit un mois avant l’insurrection
de Kronstadt, un rapport de la Tchéka (police politique
bolchevik) dénombre 118 insurrections paysannes.
Les grèves insurrectionnelles ouvrières de 1921
Rappeler tous ces éléments était nécessaire pour comprendre
le vent de révolte qui va souffler en 1921 et la rage
de tous ceux et celles qui aspiraient à une « troisième
révolution » : la véritable révolution sociale et socialiste
!
En effet, si la « révolution » est victorieuse, les
travailleurs se rendent compte que ses conquêtes leur
échappent ! La famine s’installe : on estime à
5 200 000 personnes, mortes victimes de la famine et
du froid en 1921. Alors que déjà les apparatchiks du
pouvoir s’octroient de multiples privilèges, la
décision gouvernementale du 22 janvier 1921, de réduire
d’un tiers les rations de pain pour les citadins
jette une étincelle sur un baril de poudre. Des grèves
et des manifestations suivent les meetings, vite réprimées
par les Koursantis (officiers de l’Armée rouge)
et les unités spéciales de la Tchéka. Le mouvement
prend une ampleur exceptionnelle à Petrograd.
Les bolcheviks répondent par des arrestations et des
fusillades. La plupart des mencheviks, Socialistes
Révolutionnaires (S-R) et anarchistes encore en liberté
sont arrêtés et rejoignent les centaines d’ouvriers
déjà appréhendés.
Les marins de Kronstadt demandent des comptes
Les échos de ces événements sont parvenus à Kronstadt.
Lors des premières grèves de Petrograd, les kronstadtiens
apprennent également que le pouvoir menace les ouvriers
de l’intervention de « Kronstadt-la-Rouge », «
qui les forcerait à reprendre le travail s’ils
continuaient à faire grève ». Ainsi, les bolcheviks
transformaient Kronstadt en épouvantail dans toute
la Russie pour appuyer leur politique… Les marins
envoient donc une délégation, afin de s’informer
sur le caractère du mouvement.
Le 1er mars, un meeting a lieu à Kronstadt, rassemblant
16 000 personnes (environ le tiers de la population
totale de l’île). Les représentants du gouvernement
s’y font copieusement critiqués et la résolution
du 28 février est adoptée (qui sera le « testament
politique » de la Commune). Alors, par la bouche de
Trotsky et de Zinoviev, le Comité Central du Parti
entame sa vieille rengaine et stigmatise aussitôt le
mouvement comme une rébellion contre-révolutionnaire
fomentée de l’étranger etc. Lénine écrit : « Il
est absolument évident que c’est l’œuvre
des socialistes-révolutionnaires et des gardes blancs
de l’étranger […], un mouvement petit-bourgeois
anarchiste »…
La Commune, du 2 au 18 mars 1921
Le 2 mars, 300 délégués de toutes les unités militaires
des équipages et des fabriques, se réunissent dans
le but d’élaborer les bases des nouvelles élections
du Soviet. C’est le commencement de la Commune.
Le 3 mars, parait le premier numéro des « Izvestia
» (Les Nouvelles) de Kronstadt, journal quotidien de
la Commune jusqu’au 16 mars. Toutes les prises
de position des insurgés y paraîtront.
Pendant dix jours et dix nuits harassantes, les marins
et les soldats de la ville tinrent bon contre un feu
d’artillerie continu, venant de trois côtés, et
contre les bombes, lancées par l’aviation. Pendant
la Commune, tout le Petrograd socialiste (au sens réel
du terme) et anarchiste est décimé, soumis sous la
botte bolchevik. Les équipes de la Tchéka arrêtent
tous les militants, les attroupements « de plus d’une
personne » sont interdits !
Pour mettre Kronstadt à genoux, le gouvernement devra
faire appel à des unités spéciales, laminées par la
propagande officielle et d’une fidélité aveugle
au Parti. Mais malgré cela, l’État-major de l’Armée
rouge va subir de nombreux déboires. Dès les premières
offensives, des démissions massives se produisent.
Des régiments entiers refusent de monter à l’assaut
! Ces mouvements de refus vont s’intensifier les
jours suivants : beaucoup de mobilisés veulent savoir
ce que réclament les Kronstadiens et pourquoi on les
envoie contre eux. La répression s’abat sur les
régiments « indisciplinés » : dans de nombreuses unités,
un soldat sur cinq est fusillé. Lors des attaques,
afin de prévenir la reddition des troupes, des rangs
« d’éléments sûrs » (Tchékistes, permanents du
Parti) sont placés derrière les assaillants et leurs
tirent dessus à la moindre hésitation.
Le 16 mars, l’ordre est donné de s’emparer
de la forteresse coûte que coûte. Quand les forces
gouvernementales parviennent à rentrer dans Kronstadt,
la bataille se transforme en combat de rue. Exténués
par huit jours de résistance ininterrompue, affamés,
à court de munitions, les kronstadiens décident d’évacuer
la forteresse. 8 000 d’entre eux parviendront
à se réfugier en Finlande. Ils seront arrêtés plus
tard, à leur retour, et fusillés en nombre ou entassés
dans des camps.
Si le nombre de kronstadiens tombés au cours des combats
est relativement peu élevé (comparativement aux pertes
des attaquants), il va considérablement augmenter par
le nombre de prisonniers et blessés exécutés sommairement
par leurs ennemis. Les kronstadiens vont en effet être
sauvagement pourchassés dans les rues de la ville,
les blessés achevés sur place. Dybenko, le nouveau
commandant de Kronstadt nommé par le pouvoir, revendique
900 exécutions pour la première journée où « l’ordre
» fut rétabli dans l’île. Les kronstadiens étaient
devenus des témoins gênants des « contradictions »
de la dictature du prolétariat. Par conséquent leur
seule existence continuait à représenter un danger
pour le Parti, car ils pouvaient « contaminer » le
reste de la population, en les informant de la nature
et du caractère réels de leur mouvement.
La signification politique de Kronstadt
L’objectif des insurgés de Kronstadt était clairement
une « troisième révolution ». Cette troisième révolution
fait suite à la première, contre le tsarisme, contre
la noblesse féodale et l’autocratie et à la deuxième,
contre la bourgeoisie, le parlementarisme et le capitalisme
privé. La Troisième révolution se fera, elle, contre
le césarisme bureaucratique de parti et le capitalisme
d’État, pour établir le pouvoir des Conseils,
sans parti « guide ». Si les Kronstadiens ne cèdent
pas aux sommations et ultimatums lancés par Trostsky
et ses sbires c’est donc parce qu’ils espèrent,
jusqu’au dernier moment, que leur mouvement va
servir de déclencheur à cette nouvelle révolution sociale.
Le caractère libertaire et révolutionnaire de ce mouvement
est donc indéniable. Mais pour saisir la signification
précise de Kronstadt, il faut aller plus loin. L’insurrection
marque un tournant décisif de la Révolution russe parce
qu’elle consacre l’instauration définitive
du bolchevisme. Lénine a su exploiter l’événement
pour mater et écarter « l’Opposition Ouvrière
» au sein de son propre parti ; le tout afin de passer
à la N.E.P, la Nouvelle Politique, ce qui n’eût
pas été possible sans la répression du dernier souffle
révolutionnaire du prolétariat à Kronstadt.
Du fait de sa trop brève durée et de son isolement,
Kronstadt n’atteint pas la même profondeur sociale
et révolutionnaire que le mouvement makhnoviste ou
la révolution espagnole de 1936-1937 par exemple, mais
sa démarche spontanée de classe et la netteté de ses
mots d’ordre en font un prototype accompli de
toute lutte anti-autoritaire.
Groupe Kronstadt (Lyon)
Cet article a été réalisé d’après l’excellent
livre d’Alexandre Skirda « Kronstadt 1921, prolétariat
contre bolchevisme » (Éditions de la Tête de Feuilles,
1971)
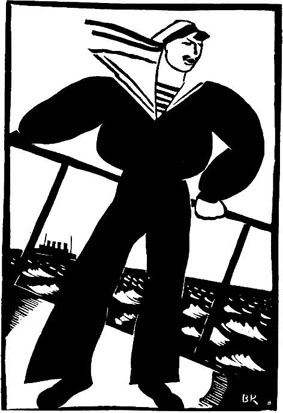 Trois tendances inconciliables vont s’affronter
: Il y avait le camp de la Réaction avec les « armées
blanches » qui tentait de réinstaurer le tsarisme ;
le camp des partisans d’une société dirigée sur
tous les plans par un « État ouvrier » ; et il y avait
aussi (et surtout) un mouvement populaire, porteur
d’une dynamique et d’un projet autogestionnaire.
L’Histoire va alors démontrer qu’entre autogestion
sociale et étatisation, il n’y avait pas d’accord
possible. Dès leur arrivée au pouvoir les bolcheviks
vont mettre en œuvre leur fameuse conception de
la « dictature du prolétariat » qui, bien évidemment,
ne signifie pas autre chose que la dictature du Parti
: « La dictature de la classe ouvrière ne peut être
garantie que sous la forme de la dictature de son avant-garde,
c’est-à-dire du Parti communiste » (Résolution
du XIIe Congrès du Parti).
Trois tendances inconciliables vont s’affronter
: Il y avait le camp de la Réaction avec les « armées
blanches » qui tentait de réinstaurer le tsarisme ;
le camp des partisans d’une société dirigée sur
tous les plans par un « État ouvrier » ; et il y avait
aussi (et surtout) un mouvement populaire, porteur
d’une dynamique et d’un projet autogestionnaire.
L’Histoire va alors démontrer qu’entre autogestion
sociale et étatisation, il n’y avait pas d’accord
possible. Dès leur arrivée au pouvoir les bolcheviks
vont mettre en œuvre leur fameuse conception de
la « dictature du prolétariat » qui, bien évidemment,
ne signifie pas autre chose que la dictature du Parti
: « La dictature de la classe ouvrière ne peut être
garantie que sous la forme de la dictature de son avant-garde,
c’est-à-dire du Parti communiste » (Résolution
du XIIe Congrès du Parti).