La République populaire de Chine vient de célébrer avec force fastes militaires, mais en l’absence du peuple, le 50e anniversaire de sa fondation, consécutive à l’arrivée au pouvoir d’un parti communiste alors nimbé d’une légitimité révolutionnaire réduite désormais à un simple slogan. En effet, le parti communiste n’a plus d’ambition idéologique : son seul objectif est de se maintenir au pouvoir en tant qu’ordonnateur à la fois de l’accumulation de plus en plus inégale des richesses et du renforcement de la puissance du pays. Le parti des prolétaires est devenu le parti des riches (1) ; l’ancien « poisson dans l’eau du peuple » ne doit désormais son assise qu’à la force de la répression.
Il est symbolique à ce propos que l’événement marquant de cette date-anniversaire du 1er octobre ait été l’exécution en grandes pompes, avec facturation en prime de la balle aux familles d’un millier de condamnés à mort à travers tout le pays, dans le cadre d’une campagne de « nettoyage tous azimuts », et selon l’adage : « Il faut tuer le poulet criminels, voleurs pour effrayer le singe dissidents, syndicalistes indépendants ». En effet, depuis quelques années, des mouvements de protestation et d’agitation sociale éclatent un peu partout, dans les villes comme dans les campagnes, remettant en cause à la fois le monopole politique exercé par le parti communiste et le mouvement de restructuration à marche forcée de l’appareil économique d’État. Et c’est le risque de convergence de la contestation dans le domaine politique et dans le domaine social qui explique l’escalade dans la répression actuellement engagée par le régime contre ce risque de « subversion ». Les caciques au pouvoir l’ont dit et redit : « La Chine n’adoptera jamais un système politique à l’occidentale et a appelé ses compatriotes à suivre, pendant les cent années qui viennent, la ligne fondamentale du parti communiste chinois » (2). « S’il s’agit d’évoluer vers un système multipartite et d’essayer de nier la direction unique du parti communiste, les nouveaux partis politiques ne seront pas autorisés » (3).
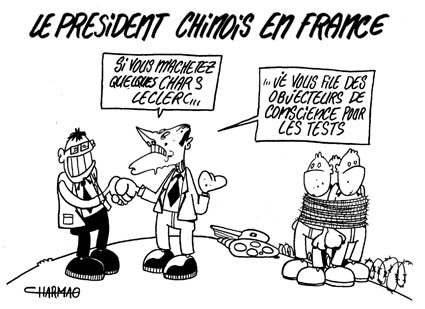
Le gouvernement chinois a pourtant souscrit à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ; il a signé tant le Pacte International « relatif aux droits économiques et sociaux » que celui « relatif aux droits civils et politiques » (4), et l’article 35 de la Constitution prévoit que « les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté de parole, de la presse, de réunion, d’association, de cortège et de manifestation ».
Mais ces textes sont réduits à néant, outre le préambule de la Constitution placée sous l’autorité de la « dictature du prolétariat », avec la promulgation le 25 octobre 1998 de deux décrets réglementant l’enregistrement et le fonctionnement des « organisations à but non lucratif indépendantes de l’État ». Malgré cette course d’obstacles kafkaïenne, le Parti Démocratique Chinois, d’orientation réformiste et libérale, qui revendique un millier de membres (5), répartis dans 23 des 30 provinces chinoises, a tenté à plusieurs reprises de se faire enregistrer, tout en reconnaissant le rôle prépondérant joué par le parti communiste dans la conduite des affaires du pays.
La réponse du pouvoir n’a pas tardé : une répression immédiate et féroce, les peines prononcées tournant en général autour de la dizaine d’années de prison. C’est ainsi que trois de ses principaux dirigeants ont été arrêtés le 30 novembre 1998 et leur procès instruit dans un délai inhabituellement court, puisque les condamnations sont intervenues dans les trois semaines ! Les 21 et 22 décembre, Xu Wenli, vétéran du premier Printemps de Pékin de 1978-79, Wang Youcai et Qin Yongmin ont été condamnés respectivement à 13, 12 et 12 ans de prison.
Même motif pour tous les trois : « tentative de subversion ». Devant la pression continue de la répression, le P.D.C. n’a pu tenir son premier congrès prévu à Wuhan (6), capitale du Hubéi au centre de la Chine, du 1er au 3 mars 1999, les principaux organisateurs ayant été interpellés. Et les peines continuent à tomber dru sur ses militants : toujours pour le même crime de « subversion », Zha Jianguo et Gao Hongmin ont été condamnés le 2 août 1999 à respectivement 9 et 8 ans de prison, Liu Xianbin et She Wanbao le 6 août à 13 et 12 ans.
Même ceux qui agissent isolement sont châtiés sévèrement lorsque leur exemple risque de faire tache d’huile. Pour avoir fourni 30 000 adresses Internet électroniques chinoises à des dissidents réfugiés aux États-Unis, Lin Hai a été condamné par une Cour de Shanghaï à 2 ans de prison pour « incitation au renversement de l’État ». Wang Wanxing, lui, est toujours interné en asile psychiatrique pour « monomanie politique », après avoir été arrêté le 3 juin 1992 place Tian Anmen, alors qu’il tentait de dérouler une banderole en mémoire des victimes de la répression trois ans auparavant, son geste étant perçu comme une « inacceptable provocation à l’égard de la direction du Parti ». Sa femme ayant demandé « qu’est-ce que la monomanie politique ? », les médecins lui ont répondu : « Il faut être fou pour vouloir manifester place Tian Anmen ! ». Wang a pourtant écrit entre temps aux autorités qu’il n’avait jamais demandé le renversement du gouvernement ni tenté de former un parti. Ce sont plutôt les hiérarques du PCC qui sont atteints de « monomanie » ! Mais ils auraient bien tort de se gêner, compte tenu de la complicité de la communauté internationale à leur égard. En effet, le 23 avril 1999, par 22 voix pour, 17 contre et 14 abstentions, la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU a voté une motion chinoise de non-examen (6) d’un projet de résolution visant à condamner les violations des libertés fondamentales et à demander la libération des prisonniers politiques en Chine.
Quant aux dissidents les plus connus, à l’instar de Wei Jing-sheng ou Wang Dan, les autorités n’hésitent pas à les exiler, en l’occurrence aux États-Unis, pour « raisons médicales ». C’est pour ce même motif que Liu Nianchun a lui aussi été expulsé vers les États-Unis le 20 décembre 1998. Il avait été préalablement condamné à 3 ans de camp de travail pour, d’une part, avoir participé en novembre 1993 à la rédaction de la « Charte pour la Paix », texte prônant la démocratie politique, et, d’autre part, avoir déposé les statuts de la « Ligue pour la protection des droits des travailleurs », organisation syndicale indépendante.
Ce que le régime craint en effet par-dessus tout, ce sont les tentatives de fédérer les mécontentements et d’établir des ponts entre la dissidence politique et les mouvements sociaux. Le pays est en effet au bord de l’explosion sociale. Dans son discours du 24 décembre 1998, le président Jiang Zemin a reconnu que « l’armée des ouvriers licenciés a augmenté » et « les revenus des paysans (9) de certaines régions sont en chute libre ». Depuis trois ans, ce sont 1 million de salariés des entreprises d’État qui sont licenciés chaque année, avec comme corollaire la perte des avantages annexes : gratuité des soins et de l’école, logement bon marché, retraites et divers services allégeant le fardeau de la vie quotidienne. Le chômage grimpe jusqu’à 30-40 % dans les anciens bastions industriels du nord du pays, comme à Shenyang, la capitale du Liaoning, où le reporter de « Libération » décrit « le marché aux bras » : « Des dizaines d’hommes sont alignés sur le trottoir près des magasins de matériaux de construction. Autour du cou ils portent une pancarte tenant par un bout de ficelle, annonçant leur spécialité chauffagiste, électricien, maçon… et ils attendent dès l’aube jusqu’au soir un hypothétique employeur, récompensé, parfois d’un travail ou d’un salaire de misère, 10 à 20 yuans la journée 7 à 14 F sans le moindre recours. » (10)
Les paysans, eux, protestent contre la corruption des cadres et les dizaines de taxes et impôts qui les accablent. « À la mi-décembre 1998, un rapport officiel de la Cour des Comptes révèle qu’entre 1992 et 1998 les bureaux officiels d’achat de grains qui reçoivent les subventions de l’État et des banques pour acheter à prix garanti leurs céréales aux paysans ont détourné 370 milliards de francs qui ont servi à des achats immobiliers d’hôtels, à des investissements spéculatifs divers, à des transactions avec des négociants privés. » (9)
Face à une telle situation, ouvriers et paysans tentent de s’organiser pour faire valoir leurs droits car, comme l’a déclaré sans ambages le syndicat officiel ACFTU lors de son 13e congrès (10) : « En tant que syndicat officiel, l’ACFTU s’engage à soutenir la politique du parti communiste, y compris les licenciements massifs dans les entreprises industrielles d’État. » C’est ainsi que, selon les chiffres officiels des ministères du Travail et de la Santé publique (11) : « 216 750 grèves et manifestations rassemblant 3,5 millions de travailleurs ont été recensées en 1998. Il y a eu 459 affrontements violents entre manifestants et police armée ayant entraîné la mort de 78 personnes et on compte 2 230 blessés dont 800 policiers ou fonctionnaires officiels. Dans 627 cas, les manifestants s’en sont pris aux locaux du gouvernement ou d’organisations officielles. » (12)
À titre d’exemple, s’est créée au Hunan, il y a un an, une « Association pour la réduction des impôts et le salut de la nation ». À Hong-Kong, Han Dongfang, un des fondateurs de la « Fédération autonome des ouvriers de Pékin » en mai 1999, déchu de sa nationalité et réfugié depuis plusieurs années à Hong-Kong où il anime une émission de radio et édite un bulletin en langue chinoise diffusé chaque mois à l’intérieur de la Chine à des milliers d’exemplaires, prône l’instauration, par le moteur d’un mouvement syndical indépendant, de « noyaux de base » de la société civile future, qu’il estime plus important que la revendication d’élections démocratiques immédiates. Mais comme pour les dissidents, la répression est très forte. Le « Bulletin des travailleurs chinois » vient de publier (13) la liste de 30 syndicalistes, appartenant soit à la « Fédération autonome des travailleurs » soit au « Syndicat ouvrier libre de Chine » (14), emprisonnés ou détenus dans des camps de travail. Les peines prononcées sont très lourdes : entre 10 et 20 ans et les motifs toujours aussi mensongers : « fraude », « pillage », « hooliganisme », « crime contre-révolutionnaire », « espionnage pour le compte d’organisations basées hors de Chine ». Aussi, face à cette répression, certains désespérés n’hésitent pas à employer la manière forte. D’après Libération (15), au moins quatre attentats à la bombe se sont produits au cours du seul mois de janvier : deux dans le Hunan, un dans le Liaoning et un près de Hong-Kong. Bilan : 28 morts et 106 blessés.
Si le parti communiste reste en apparence accroché fermement à son pouvoir, il n’a plus d’assise populaire et n’est fort que par défaut, face à une société qu’il tente de maintenir fragmentée et atomisée, mais qui est en train, petit à petit, de renouer avec des solidarités, certes catégorielles au départ, mais porteuses à terme d’un changement social à voir la façon dont, sur le terrain, elles cherchent à établir des passerelles dans ce sens.