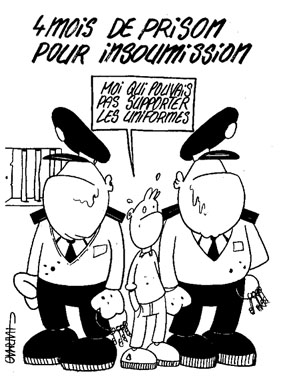Paroles d’insoumis
Face à l’armée, seule la lutte
paie
« Si mes soldats commençaient
à penser, aucun d’eux ne resteraient
dans les rangs. »
Frédéric II
Le 18 octobre dernier, j’étais condamné
par la Chambre des affaires militaires de Marseille à quatre mois
de prison ferme, pour insoumission et refus d’obéissance au premier
et dernier ordre qui m’a été donné, celui de revêtir
l’uniforme et d’effectuer mes « obligations militaires ». À
l’occasion de la commémoration de cet immense bain de sang que fut
la première guerre mondiale, je tiens donc à expliquer publiquement
les raisons motivant mon insoumission à toute forme de service national.
L’armée a toujours été
un instrument d’oppression au service de l’État, oppression généralement
exercée sur des peuples étrangers. Il suffit, pour s’en convaincre,
de se plonger dans l’histoire et d’observer. Dès l’antiquité,
des troupes combattirent afin d’imposer l’autorité de ceux qu’elles
servaient, pillant les territoires conquis et permettant que les vainqueurs
puissent vivre en parasites sur les vaincus. Et précisons que les
seuls vainqueurs étaient les hommes de pouvoir, et non le peuple.
Ayant conscience de cela, nous pourrions maintenant nous étonner
de la soumission qui continue de régner, et qui laisse libre cours
aux appétits de ces quelques privilégiés. Pourtant,
les raisons en sont simples. D’une part, chaque État, quel que soit
son régime politique, utilise l’éducation afin de renforcer
son autorité. En France par exemple, cela consiste à façonner
de petits républicains en leur inculquant le respect des valeurs
nationales. Lorsque j’étais au collège ? et n’ayant que 24
ans, je n’évoque pas des temps lointains ? nous devions ainsi assister
à des cours d’éducation civ ique. Or, dans les pages de nos
manuels scolaires, plutôt que des leçons sur la vie en collectivité,
le respect d’autrui, etc. nous trouvions des explications sur le fonctionnement
des institutions nationales, sans bien sûr le moindre regard critique.
Imaginez donc un manuel évoquant les corruptions, les fraudes électorales,
les emplois fictifs…
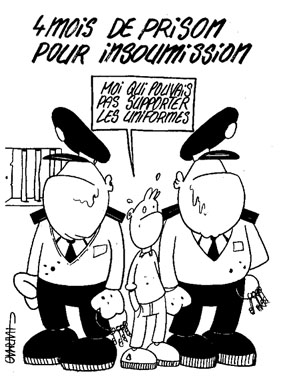
Cependant, cette première institution
ne suffisant pas pour garantir aux puissants la préservation de
leurs intérêts, une seconde était nécessaire.
Là se dresse l’arsenal judiciaire, chargé de faire appliquer
la loi. Mais si la loi peut paraître respectable pour beaucoup, une
interrogation permet d’en éprouver les limites. En effet, qui sont
ceux qui éditent ces textes auxquels nous devons impérativement
nous soumettre ? Les hommes de pouvoir. La loi serait-elle alors injuste
? À cela je répondrais parfois par l’affirmative, l’ayant
vécu récemment. Pour m’être publiquement opposé
à une institution de l’État, pour avoir dit que j’ignorais
ce qu’était la nation, me sentant davantage citoyen du monde, pour
ne pas avoir dissimulé mon engagement au sein du mouvement libertaire,
j’ai été condamné à quatre mois de prison ferme.
Au cours des siècles, lorsque le
péril fut trop grand pour les privilégiés, lorsque
leur puissance fut remise en cause, ils n’hésitèrent pas
à appeler l’armée afin de restaurer leur « ordre »
à l’intérieur des frontières. En 1871 par exemple,
les parisiens s’opposèrent au gouvernement qui voulait capituler
face aux Prussiens, et proclamèrent la Commune. Les troupes versaillaises,
fidèles à l’État, s’entendirent alors avec celles
d’outre-Rhin pour imposer de nouveau, dans une répression terrible,
leur autorité. De même, en 1894, l’armée ouvrit le
feu sur des ouvriers en grève à Fourmies, parvenant ainsi
à les soumettre.
Aussi, lorsque, le 6 septembre 1999, je
me rendis à la caserne de Caipiagne, ce n’était pas pour
endosser l’uniforme, ni pour me soumettre à ce principe selon lequel,
comme me l’a si justement rappelé le procureur, « je dois
dix mois de ma vie à la nation ». Par conséquent, en
fonction de mes convictions personnelles, je refusais et condamne toujours
toute forme de service national : le militaire, pour les raisons expliquées
précédemment, et le civil parce qu’il permet de disposer
des jeunes durant 18 mois à un salaire dérisoire, plutôt
que de créer des emplois véritables.
Le 28 octobre, j’ai été définitivement
réformé, l’armée considérant ma rigidité
et mon engagement incompatibles avec son fonctionnement. Mais aujourd’hui,
ayant fait appel du jugement, j’attends toujours que les juges choisissant
la justice, et non la loi, et referment le casier judiciaire qu’ils m’ouvrirent
le 18 octobre.
Cédric Dupont