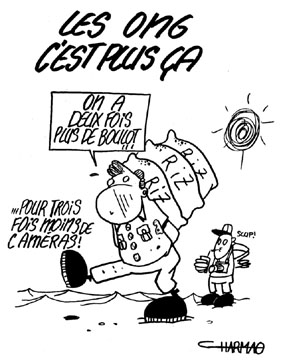Action humanitaire
L’instrumentalisation de la misère
« L’action
humanitaire sera
la nouvelle politique de demain »
B. Kouchner, 1993
S’il y a un scandale dont on peut s‘émouvoir,
c’est celui de l’essor de l’action humanitaire. Son ampleur est telle qu’elle
est devenue en quelques décennies un secteur économique à
part entière, et que l’O.N.I.S.E.P. (1) consacre une de ses récentes
brochures à la question (2). Il y a beaucoup de raisons à
cet essor, principalement pécuniaires et politiques. Sur ce terrain,
on retrouve essentiellement deux catégories d’institutions : les
associations (que l’on appelait il n’y a pas dix ans les associations caritatives)
et les entreprises d’insertion. Si l’on prend ces dernières, on
peut voir que leurs dirigeants sont à 43 % d’anciens chefs d’entreprise
ou des cadres (30 % de patrons, 13 % de gérants, ingénieurs,
assureurs etc.) contre 48 % de gens issus du secteur associatif ou social,
ce qui tend à laisser penser que l’enjeu financier est de taille.
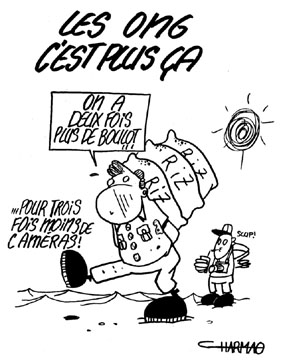
Beaucoup d’associations ou d’entreprises
à vocation humanitaire sont l’émanation directe des pouvoirs
publics, des mairies, des conseils généraux ou régionaux.
Ces structures ont à leur disposition de nombreux avantages financiers,
dont la facilité du classement d’utilité publique (qui permet
de toucher de nombreuses subventions, ce qui peut expliquer que le caractère
revendicatif premier comme les combats pour un logement, un revenu etc
est souvent effacé et réorienté avec l’arrivée
de la subvention) et également tout un arsenal législatif
(et des institutions comme le C.N.A.S.E.A.) (3) qui leur permet d’engager
à bas coûts, et le plus souvent à bas salaires (grâce
aux contrats C.E.S., aux objecteurs de conscience ou dernièrement
aux emplois jeunes) des travailleurs en grande difficulté sociale.
On a donc dans le secteur de l’insertion des entreprises et des associations
qui maintiennent une population dans la pauvreté et l’instabilité
sociale. Rajoutons à cela le bénévolat, forme de travail
non négligeable au sein des associations (y compris dans les associations
humanitaires) voire même la forme de travail prépondérante
au sein de certaines structures qui permet de disposer d’un travail gratuitement.
Le paysage « humanitaire »
Lorsqu’on observe le secteur humanitaire,
on a affaire à de l’aide à l’insertion, à de l’aide
à l’alphabétisation, à de l’aide médicale,
à du secours aux pauvres, à de l’assistance juridique… Le
tout paraît confus et sans lien évident. Il ne faut surtout
pas se fier aux apparences, et la coordination de l’action humanitaire
existe depuis longtemps. On a par exemple en ce qui concerne le logement
la fédération PACT-ARIM qui regroupe des associations comme
Droit au logement, Fondation abbé Pierre, Secours populaire, Secours
catholique, etc., le tout en une cinquantaine d’associations. Pour l’aide
aux chômeurs, la liste des organismes qui coordonnent l’action des
associations et des entreprises d’insertion est longue, il y a d’abord
le FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil
et de réadaptation sociale), le CNEI (Comité national des
entreprises d’insertion), les COORACE (Coordination des organismes d’aide
aux chômeurs par l’emploi) qui fournit des petits boulots aux chômeurs,
c’est cette fédération qui diffuse son travail sous la marque
Proxim’Services.
On le constate donc, les associations
et entreprises d’insertions sont loin d’être une émanation
chaotique et conjoncturelle mais elles deviennent un moyen de gérer
l’urgence et d’en refabriquer de façon à se légitimer.
Ces ensembles sont assez souples et relativement organisés, et ils
collent souvent au terrain.
L’humanitaire, une solution ?
C’est en cela que l’action humanitaire est
une solution des hommes politiques à la crise mais sans être
une solution politique à celle-ci. L’essor de ce secteur est une
utilisation de ces structures par pouvoir faire face à la misère.
Par le biais de ces associations, il fait effectuer un travail à
des organismes privés, qui deviennent donc beaucoup plus que des
associations caritatives en effectuant le travail de la collectivité.
Chaque organisme privé sélectionnant sa « clientèle
» (de manière plus ou moins subtile, comme le montre l’exemple
de Fraternité françaises) (4), l’utilisation de l’argent
public se fait de façon injuste car les prestations fournies (qui,
rappelons-le, ne sont pas un droit pour la personne qui va en bénéficier)
le sont au bon vouloir de l’association.
La question de la justice sociale qui
nous anime nous anarchistes est donc reléguée au placard,
et le désengagement de la collectivité, des questions de
répartition, d’éducation et de santé provoqué
et aidé par l’État est inacceptable. La politique de «
ciblage » des populations assistées par les associations ou
par les aides publiques (comme le RMI ou l’Aide Médicale Universelle)
est une politique de ségrégation sociale, c’est-à-dire
la pire chose qui soit dans le capitalisme. L’action humanitaire fait partie
d’un processus construit par le pouvoir pour renforcer son chantage et
la dictature de l’urgence devient la justification de toutes les interventions,
y compris armées, comme on l’a vu récemment au Kosovo, et
également dans le conflit au Rwanda. Cette instrumentalisation de
la détresse des populations fait que les anarchistes ne peuvent
cautionner ce genre de chantage où le massacre des uns justifie
la destruction des autres.
Nous nous plaçons dans l’optique
de l’égalité économique et sociale entre tous les
individus et les moyens de lutte contre la misère doivent être
en accord avec nos idées, et il appartient à la collectivité
de se réapproprier, par la lutte autogestionnaire ce qui la concerne,
c’est à dire tout ce qui relève de l’éducation, de
la santé, du travail, de la culture, de la solidarité internationale.
Sam. — groupe Jules-Vallès, (Grenoble)
(1) Office national de l’information
sur les enseignements et les professions
(2) Info-sup n° 179.
(3) C.N.A.S.E.A. : organisme relevant
du ministère de l’agriculture qui, dans les années 70, assurait
la gestion des objecteurs de conscience, et qui, petit à petit,
s’est mis à gérer tous les contrats précaires dans
les administrations et les associations.
(4) Officine caritative du Front national,
réservée aux « bons français exclusivement ».