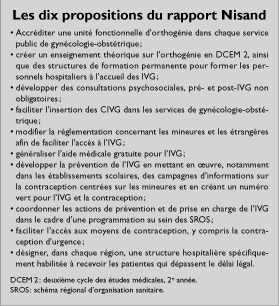IVG : un droit fondamental mis en difficulté
A la demande de Martine Aubry, ministre de
l’emploi et de la solidarité, et de Bernard Kouchner, alors secrétaire
d’État à la santé et à l’action sociale, le
professeur Israël Nisand (1) a remis en février 1999 un rapport
sur la situation de l’IVG en France. Si nous revenons sur ce rapport, c’est
qu’il était entendu qu’il serait suivi d’effet, c’est-à-dire
que les propositions évoquées « pour diminuer les difficultés
que rencontrent les femmes » se traduiraient en actions. Martine
Aubry l’avait annoncé, notamment dans un communiqué en date
du 19 mars 1999…
Or les femmes ne voient rien venir et
les militantes féministes s’impatientent. C’est pourquoi, pour les
25 ans de la loi dite Veil, une manifestation nationale s’organise pour
le 15 janvier 2 000. Parmi les revendications féministes actuelles
concernant le droit à l’emploi et à un salaire décent
ou la dénonciation de toutes les violences, les revendications pour
la liberté de l’avortement apparaissent comme fondamentales tout
comme celles relatives à l’accès à la contraception
: ce sont celles qui permettent, en d’autres termes, de pouvoir choisir
sa vie en toute liberté.

Le rapport Nisand a le mérite de
dresser l’état des lieux des difficultés rencontrées
par les femmes en demande d’interruption volontaire de grossesse : il permet
ainsi de faire des propositions qui s’appuient sur des faits actuels. Grâce
à la participation active de militantes de la CADAC (Coordination
des Associations pour le droit à l’avortement et à la contraception),
du MFPF (Mouvement français pour le planning familial), de l’ANCIC
(Association nationale des centres d’interruption volontaire de grossesse
et de contraception) et de la fédération SUD-CRC (fédération
syndicale dans le secteur sanitaire et social), le rapport décrit
dans le détail les anomalies, irrégularités, difficultés,
entraves dans l’application de ce droit : « des difficultés
dont ne semblent se soucier ni le législateur ni les structures
dont la réponse est insuffisante tant au plan quantitatif qu’au
plan qualitatif ».
En effet, l’activité d’IVG reste
marginalisée dans les établissements publics : les professionnels
médicaux et paramédicaux qui furent militants dans les années
70 pour implanter cette activité à l’hôpital n’ont
pas de relève d’autant qu’ils sont le plus souvent vacataires et
que le service n’a pas le statut des autres services hospitaliers : centres
autonomes ou CIVG, unités fonctionnant dans le cadre d’un service
hospitalier avec affectation de locaux et de personnels, ou d’activités
d’IVG pratiquées par un service sans affectation spécifique
de personnels et de locaux. Si bien que le contingentement systématique
du nombre d’actes par manque de moyens ou par volonté, les difficultés
de recrutement des professionnels, l’accueil mal adapté, la faible
disponibilité de l’IVG médicamenteuse, ne permettant pas
d’assurer la continuité du service public ni la qualité de
prise en charge requise. Ainsi, faute de trouver une écoute ou un
rendez-vous à l’hôpital public dans des délais rapides,
des femmes sont contraintes de rechercher une solution dans le secteur
privé, parfois à la limite du délai légal ou
le dépassant. En 1998, 857 établissement assuraient des IVG
dont 449 dans le secteur public : 52,3 % des IVG seulement ont été
réalisées par l’hôpital public en 1992 (47,7 % en clinique
privée), et deux tiers des IVG sont effectuées dans le secteur
privé en Ile-de-France. Régulièrement, est rappelée
par circulaire ministérielle la nécessité de mieux
répondre à la demande en limitant les difficultés
et surtout durant les mois d’été. Mais aucune solution n’est
envisagée et des services hospitaliers publics pratiquant les IVG
ferment l’été.
Inégalités face à l’avortement
Or, dans le secteur privé, des structures
abusent les femmes : aucune information sur le recours à l’aide
médicale gratuite, examens radiologique et biologiques superflus,
une très grande fréquence d’utilisation de l’anesthésie
générale, une durée d’hospitalisation plus longue
que dans le secteur public.
« Trois catégories de femmes
connaissent un désarroi particulier » relève Israël
Nisand. Tout d’abord, celles qui dépassent le délai légal
de 10 semaines de grossesse. Cette contrainte actuelle pèse tout
particulièrement sur les femmes en situation de précarité
et aggrave les inégalités sociales dans ce domaine où
le recours aux soins est souvent tardif voire impossible chez des femmes
isolées. « Une augmentation de deux semaines du délai
légal ferait diminuer le nombre de ces Françaises (qui partent
avorter à l’étranger) (2) de 80 % et alignerait la France
sur le délai légal le plus courant en Europe ».
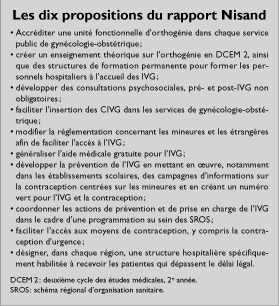
Viennent ensuite les femmes étrangères
pour qui il est exigé un séjour de trois mois dans le pays,
ce qui provoque des situations sociales et humaines dramatiques. Le risque
de tourisme abortif redouté n’a aucun fondement : tous les pays
européens, sauf l’Irlande, ont adopté une loi relative à
l’IVG.
Quant aux femmes mineures, « elles
sont dépossédées de leur autonomie en ce qui concerne
l’IVG. Elles peuvent accoucher sous X sans autorisation parentale, obtenir
des contraceptifs et poursuivre une grossesse ». Mais elles doivent
demander l’autorisation parentale si elles veulent avorter et n’ont aucun
recours juridique en cas de refus parental. Pour l’auteur du rapport, «
la solution réside donc plutôt dans l’affirmation d’un droit
propre de la jeune fille à décider de l’IVG en lui garantissant
la confidentialité de sa décision ».
L’IVG est le seul acte médical
ou médico-chirurgical dont la réalisation nécessite
une déclaration pour ne pas être illégal. Chaque femme
connaît en moyenne une grossesse non désirée au cours
de sa vie et l’interrompt une fois sur deux. Depuis 1976, on peut observer
une légère baisse du nombre d’IVG. Le rapport Nisand démontre
que la légalisation (très encadrée) de l’avortement
n’a pas entraîné sa banalisation, pas plus qu’elle n’a conduit
au relâchement de la contraception. L’avortement, en France, joue
essentiellement un rôle palliatif de l’échec de la contraception.
Pour autant, même s’il existait une
politique volontariste de prévention des grossesses non désirées,
il persisterait toujours des demandes d’IVG parce que les méthodes
contraceptives ne sont ni parfaites ni parfaitement utilisées et
qu’il y a une réelle différence entre désir de grossesse
et désir d’enfant. Il ne faut en effet ni opposer contraception
et avortement, en pensant que l’un est le substitut automatique de l’autre,
ni croire qu’ils vont automatiquement de pair. L’avortement reste bien
l’expression d’une contradiction entre le désir des femmes et les
réalités sociales, économiques et familiales.
Bousculons le gouvernement
La médicalisation de l’avortement a
entraîné une chute spectaculaire des complications et des
décès. Alors qu’il était estimé à un
décès par avortement par jour dans les années 1960
et à 2 par mois à la veille de la loi de 1975, le nombre
annuel absolu de décès par IVG se situe entre 0 et 2. En
outre, « l’lVG ne modifie pas la fécondité ultérieure
des femmes et les indicateurs de morbidité devraient encore s’améliorer
avec la diffusion des méthodes médicamenteuses et l’usage
plus large de l’anesthésie locale ».
Si un certain nombre de propositions de
Nisand devraient être reprises comme celle qui consiste à
préconiser des consultations psychosociales pré et post-IVG
non obligatoires ou celle qui recommande des campagnes d’informations sur
la contraception, celle qui permettrait aux mineures et aux étrangères
d’accéder directement à l’IVG sans autorisation parentale
et sans justificatif de séjour en France, il n’en reste pas moins
que la proposition de rattacher toute activité d’avortement à
un service de gynécologie-obstétrique renforce l’hospitalo-centrisme
et la médicalisation même si l’objectif vise à donner
un statut aux professionnels et au service assurant les IVG.
En ces temps d’ordre moral nauséabond,
le rapport Nisand apparaît audacieux. C’est sans doute pourquoi Aubry,
Jospin et Nisand ont reçu tant de lettres de menaces de mort. Nisand
a aussi reçu des messages abjects : il vient de déposer plainte
pour injures antisémites. C’est sans doute pourquoi aussi aucune
des propositions n’a pu encore déboucher. La volonté politique
n’y est pas : il va falloir la bousculer.
Hélène Hernandez. — groupe Pierre-Besnard
(1) Chef de service de gynécologie-obstétrique
du CHU de Strasbourg.
(2) 5 000 femmes se rendent chaque année
à l’étranger : non seulement elles doivent débourser
les frais de voyage et payent cher l’IVG, mais celui-ci n’est pas toujours
réalisé dans de bonnes conditions.