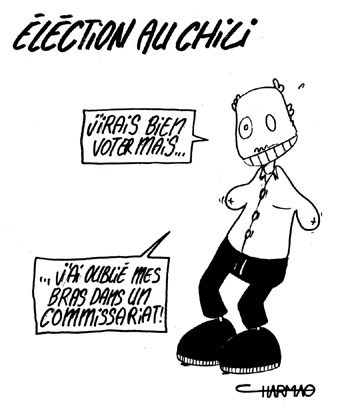Dix ans après la fin de la dictature
Chili : la droite dure revient en force
Pour comprendre pourquoi le pinochétisme
pourrit la vie politique du Chili depuis le retour de la démocratie,
il y a dix ans, il faut faire un petit retour en arrière. En 1980,
au zénith de son pouvoir, Pinochet remplace la Constitution de 1925
par la sienne sans débat public ni possibilité de présentation
d’amendements ou de modifications. Cette constitution prévoit une
série d’articles qui seront autant de boulets aux pieds de la démocratie,
qui seront surnommés les lois-amarres.
D’abord, cette Constitution prévoit
que Pinochet restera président jusqu’en 1988. Cette année-là,
il y aura un plébiscite pour que la population décide si
elle veut que le régime militaire continue. Si oui, pas d’élections
avant 1997. Si non, élections en 1989. Il est clair à cette
époque que Pinochet croit vraiment qu’il a l’appui de la grande
majorité des chiliens et que les opposants ne sont que quelques
subversifs que ses polices secrètes s’efforcent d’anéantir.
Deuxième loi-amarre : Pour ne pas
courir le risque qu’un futur parlement démocratique réforme
la Constitution, il faut garder le contrôle du Sénat où
se décidera le destin final de tout projet de loi. À cet
effet, Pinochet crée 10 postes de « sénateurs institutionnels
», désignés tous les 8 ans par le président
de la République, donc en 1980 lui-même ; par les Forces armées,
par les recteurs d’université (qu’il a lui-même désignés),
par le président de la Cour des comptes (qu’il a lui-même
désigné) et par les juges de la Cour suprême (vous
avez deviné, qu’il a lui-même désignés). De
plus, il crée les "sénateurs à vie" qui sont les présidents
chiliens qui ont gouverné pendant au moins six ans ; il est le seul
dans ce cas.
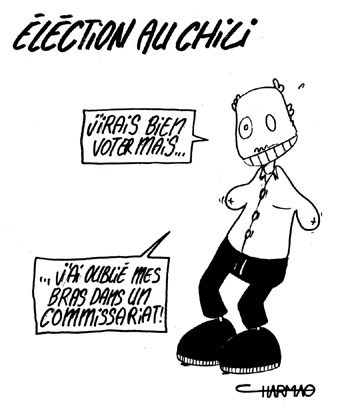
Ainsi donc le Sénat comporte 28
membres élus (dont 11 de droite), 10 désignés et un
à vie. Or toute réforme importante exige les 2/3 des votes.
Le Sénat restera donc toujours contrôlé par le pinochétisme.
Autre loi-amarre : le président de la république n’a pas
le droit de désigner les commandants en chef des forces armées,
donc d’y placer des officiers non pinochétistes. Autre loi, 10 %
du revenu total de la vente du cuivre chilien, une des principales sources
de dollars, revient d’office aux forces armées qui les dépensent
sans aucun contrôle de l’Etat.
Mais en 1988, surprise : le régime
avait mal calculé l’ampleur du mécontentement populaire.
Il perd le plébiscite. Puis il perd les élections de 1989.
Lorsque la Concertation gagne ces élections, elle a le pouvoir d’appeler
à une nouvelle constituante. Il est clair que la droite, choquée
par sa défaite, n’aurait pas pu réagir. Un coup d’Etat militaire
était à ce moment impossible ; avec un million de gens dans
les rues de Santiago, les yeux du monde étaient dirigés vers
le Chili et même le président des Etats-unis faisait bien
comprendre à Pinochet qu’il n’était pas question d’actions
intempestives. Mais les politiciens, toujours inquiets par des manifestations
populaires, eurent peur de ne plus contrôler la situation et préférèrent
négocier avec le régime militaire un accord secret selon
lequel la Concertation accepterait de respecter la constitution de 1980.
Le Chili entrait en transition vers une démocratie parlementaire
surveillée par les militaires. Il l’est toujours.
1er tour : la peste au coude à coude
avec le choléra
Le 12 décembre dernier, les chiliens
votaient donc pour le premier tour de l’élection de leur troisième
président de la république depuis la fin de la dictature.
Six candidats représentant quatre petits partis et deux coalitions
se disputaient le vote de 8 millions d’électeurs.
Les deux grandes coalitions sont, à
droite, l’Alliance pour le Chili et, au centre, la Concertation des partis
pour la démocratie, au pouvoir depuis la fin de la dictature en
1990.
Lagos (Concertation), a remporté
de toute justesse le premier tour des élections présidentielles
(47.96 %) devant Lavin (47.52 %). Il n’est plus du tout impensable d’envisager
un président de droite au Chili pour l’an 2000. Comment cela est-il
possible dix années à peine après la fin du régime
militaire ? Première constatation, les électeurs inscrits
ont voté massivement pour les deux poids lourds, balayant complètement
les autres candidats. Deuxième constatation, la droite dépasse
de très loin son plafond traditionnel de 35 % et la Concertation
s’effondre de plus de 12 %. L’égalité virtuelle des voix
au premier tour est, de fait, une victoire de la droite !
La droite dure bien placée
L’absence du général à
Londres a donné à Lavin l’espace nécessaire pour se
présenter sous les traits d’un jeune cadre dynamique apolitique
: ayant habilement pris soin de ne jamais utiliser le langage pinochétiste
dans ses rassemblements et de ne pas s’entourer trop ouvertement de politiciens
liés au dictateur, il a attiré un nombre important de voix
provenant de la Démocratie chrétienne dont les secteurs durs
se sont toujours refusés « à voter pour un socialiste
», même si cela signifiait ne pas respecter la politique du
parti. Il est également clair que de nombreux déçus
de la Concertation se sont joints à eux.
Une autre source d’électeurs, plus
surprenante, est le peuple Mapuche. La région de l’Araucanie a massivement
voté à droite. Une explication serait que les Mapuches, ne
s’étant jamais impliqués dans les partis politiques anti-Pinochet,
n’ont pas souffert la répression féroce qu’ont subi ces partis.
Pour eux, la Concertation ou l’Alliance sont simplement deux options. Or
la Concertation ayant violemment fait réprimer les revendications
indiennes durant ces derniers mois, il était évident qu’elle
perdrait le vote Mapuche. Ne croyant pas aux petits partis, les Mapuches
ont massivement voté Lavin (56 % des voix de cette région
contre 40 % à Lagos et 1,2 % au PC qui les a pourtant toujours défendus).
Un autre vote surprise pour Lavin est
celui… des femmes. 53 % des femmes ont voté Lavin. Celui-ci s’est
toujours présenté en public accompagné de sa femme
et de ses sept enfants, donnant l’image d’une jeune famille chilienne idéale,
« type publicité à la télé », qui
a joué fortement en sa faveur. Les analystes estiment que les femmes,
plus sensibles que les hommes aux problèmes de la délinquance
et du chômage pour leurs répercussions sur la famille, ont
accepté le message de Lavin promettant une plus grande sécurité
dans les rues et plus d’emplois. Pour finir, le vote nul et blanc ne dépasse
pas 3 % ce qui signifie que nombre d’indécis ont choisi Lavin.
10 ans de libéralisme effréné,
ça coûte cher
La Concertation est née en 1989 de
l’union de toutes les forces anti-dictatoriales et rassemblait alors 17
partis, de la Démocratie chrétienne au PC en passant par
les divers PS. Peu à peu, les « grands » partis ont
absorbé les « petits » et d’autres (PC, écolos,
humanistes) ont quitté la Concertation en désaccord avec
sa politique de consensus avec les partis de droite.
L’investiture pour la Concertation avait
été gagnée haut la main (70 %) par Ricardo Lagos lors
d’élections primaires qui l’ont opposé au DC Andrés
Zaldivar. Mais il s’est attiré la rancœur de l’aile dure de la DC
peu encline à « voter pour un socialiste ». Ces secteurs
ont massivement votés à droite, leur tendance naturelle.
La fuite des voix DC vers Lavin pourrait annoncer la mort de la Concertation.
La politique générale de
la Concertation durant ses 10 années de gouvernement lui a coûté
cher. À l’usure naturelle du pouvoir, il faut ajouter son acceptation
totale d’un néolibéralisme effréné.
Malgré quelques réformes
sociales positives et une diminution indéniable de la grande pauvreté,
c’est elle qui a privatisé l’eau et l’électricité,
réprimé les Mapuches qui luttent contre les multinationales
de l’extraction sauvage du bois, provoqué les dures grèves
des travailleurs de la culture, des ports et du secteur médical,
été incapable de démocratiser les institutions et
voulu ramener Pinochet au Chili. À tout cela, on peut ajouter une
montée du chômage depuis 15 mois suite à la crise asiatique,
une politique de consensus avec la droite qui bénéficie systématiquement
à celle-ci, sans parler d’une gestion brouillonne du projet de réforme
des lois du travail finalement rejeté par le Sénat en partie
à cause d’hésitations démocrates-chrétiennes…
La forte abstention durant les élections
précédentes annonçait un désenchantement croissant
des gens, mais les électeurs d’alors n’étaient pas encore
prêts à voter à droite. La Concertation, dans son isolement
teinté d’une certaine arrogance, n’a rien vu venir. Le pouvoir aveugle
toujours ceux qui le détiennent…
Un avenir peu radieux
D’ores et déjà, on peut considérer
que l’égalité virtuelle des voix est une grande victoire
pour la droite. Pour les anti-pinochétistes, ces élections
sont un désastre. Ecouter les personnalités gouvernementales
« appeler à la responsabilité » des électeurs
alors que ce fiasco est de sa faute, est pathétique. Il ne manque
que quelques voix sur plus de 8 millions pour que la droite la plus dure
et conservatrice d’Amérique latine, fondamentalement pinochétiste,
gouverne le Chili. Avec l’accord d’une majorité de ses habitants.
Rendez-vous pour le second tour le 16 janvier… Ce serait vraiment le comble
de voir Pinochet extradé à Madrid pour y être jugé
alors que le parti pinochétiste gagne les élections au Chili.
Ce n’est pas de la politique fiction, c’est malheureusement une possibilité
bien réelle.
Le correspondant de Visages d’Amérique
latine (sur Radio Canut, Lyon) à Santiago.