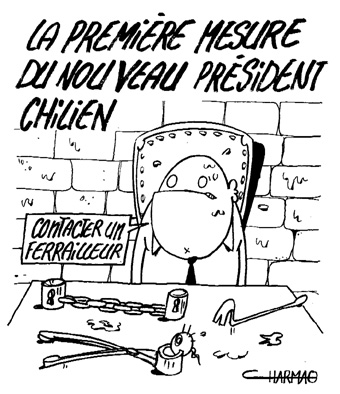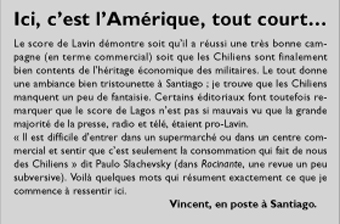Chili : vrai-faux changement sur fond de recomposition
politique
La Concertation démocratique
et l’Alliance pour le Chili, c’est-à-dire le centre et la droite
se rapprochent à pas de géant. Le deuxième tour des
élections se termine par une victoire numérique de la Concertation
(51,31 % des voix) mais par une victoire psychologique de la droite (48,69
%). L’abstention représente 10 % et les votes blancs ou nuls 4 %.
La principale caractéristique fut la recherche des électeurs
du centre politique par une dé-pinochétisation des discours
et la dé-politisation des programmes.
Les analyses montrent qu’au premier tour
des élections, près d’un million d’électeurs de la
Concertation (15 %) avaient voté pour Lavin (voir ML n° 1186).
Au second tour, Lagos a bénéficié du retour de quelques
électeurs vers la Concertation, mais surtout de votes utiles. Ce
sont les partis humanistes, écologistes et un fort contingent communiste
qui l’ont sauvé du désastre…
La Concertation : glissement du centre gauche
vers le centre droite
Née en 1988 du rassemblement de 17
partis anti-Pinochet (du PC à la DC), la Concertation a gagné
les élections de 1989 et de 1993. A chaque fois, ses politiques
centristes et la « politique des consensus » avec la droite,
lui faisaient perdre des voix sur sa gauche. Elle ne compte actuellement
plus que 4 partis : la DC, le PS, le tout petit Parti radical et le Parti
pour la démocratie (PPD), un PS « rénové ».
Les deux premiers Présidents de l’après dictature furent
démocrates-chrétiens. Mais en mai dernier, le PPD Ricardo
Lagos, après un parcours sans faute dans les ministères de
l’Education et des Transports publics des deux gouvernements de la Concertation,
avait pris tellement de poids qu’il fallut une primaire pour le départager
du DC Andrés Zaldivar en vue des présidentielles. Le «
socialiste » Lagos gagna haut la main et la Concertation perdit les
votes de l’aile droite de la DC.
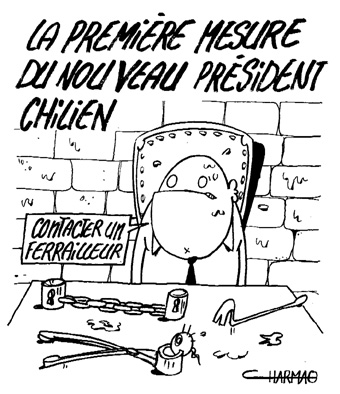
Pour les regagner et convaincre les indécis
du centre, Lagos avait réalisé une campagne « sérieuse
». Discourant en cravate de thèmes politiques face à
des rassemblements de militants, Lagos exhibait les défauts majeurs
de la Concertation : arrogance du pouvoir et perte de contact avec la réalité
des gens. Son mauvais résultat au premier tour l’a obligé
à de nouveaux choix de campagne. Deux alternatives : reconnaître
que la Concertation s’était reposée sur ses lauriers et avait
encore beaucoup à faire, ou alors au contraire, revendiquer ses
acquis pour récupérer les électeurs transfuges. Ces
acquis (dans le cadre d’une gestion politique acceptant les contraintes
du « marché ») sont réels : basse inflation,
diminution de la grande pauvreté, augmentation du salaire minimum
et du niveau de vie, investissements dans les ministères sociaux,
réforme de la structure judiciaire, développement des infrastructures.
En ce sens, la Concertation, dite de centre-gauche, a parfaitement géré
le système néolibéral. Mais elle n’a pas senti la
colère des gens face à une forte montée du chômage
(de 7 à 11 % en 15 mois) dûe à la crise asiatique qui
a durement touché l’économie chilienne, ni son sentiment
d’insécurité croissant face à une délinquance
toujours plus violente, ni son désir de faire entendre ses préoccupations
quotidiennes. Le pouvoir provoque toujours une arrogance qui le distancie
inévitablement du peuple, vieille histoire bien connue…
Pour regagner du terrain, Lagos adopta le
style qui avait fait le grand succès de son adversaire : dépolitisation
du discours (mais en manches de chemise), populisme « serre-toutes-les-mains
» et promesses directes concernant des thèmes très
précis. Le programme électoral abandonnait le terrain des
grandes politiques d’Etat pour un développement vers une société
plus juste (le slogan du premier tour n’était-il pas « Croissance
dans l’égalité » ?) pour tomber dans celui de la résolution
de problèmes très locaux par un torrent de promesses. Et
sa popularité remonta !
Pour reconquérir le vote féminin,
Lagos mit en avant Soledad Alvear, ex-ministre DC de la Justice et personnalité
très appréciée des Chiliens. Succès tout relatif.
Pour regagner le vote de ses adhérents de droite, la DC mit toute
la vapeur et les partis socialistes et PPD furent priés par leur
chef de ne rien dire sur les thèmes politiques (démocratisation
des institutions ou droits humains par exemple). Aucun succès visible
!
La droite de Joaquin Lavin : Pinochet enfin
sur une voie de garage ?
N’en déplaise à une vision manichéenne
de la presse européenne et de la gauche en général,
Lavin et Pinochet, ce n’est pas la même chose. Pinochet a toujours
ignoré Lavin, sa première tactique fut d’abord de briser
la Concertation en se montrant favorable au président de la DC,
Andrés Zaldivar. Lorsque la DC refusa, Pinochet créa de toutes
pièces le candidat Frei Bolivar, un ex-DC ambitieux qui, se voyant
déjà président, a embrassé la cause pinochétiste.
Mais l’armée ne fut pas convaincue et Pinochet abandonna son nouvel
allié.
Pendant ce temps, Lavin parcourait le pays,
sans Pinochet et ses partis, sans le soutien des milieux d’affaires ou
des militaires. Sa grande religiosité (il est membre de l’Opus Dei),
sa famille nombreuse, jeune et très « comme il faut »,
ses constantes déclarations de guerre à la pauvreté,
au chômage et à l’insécurité, ses multiples
promesses ainsi que sa bonne gestion municipale (il est maire de Las Condes,
la commune la plus riche du pays) lui attirèrent un grand soutien
populaire et une remontée spectaculaire dans les sondages. Lavin
est ainsi devenu candidat unique de la droite non pas grâce à
mais malgré les pinochétistes…
Sa dé-pinochétisation n’est
pas factice : pour gagner des voix au centre, seule possibilité
de rompre le monopole de la Concertation sur ce secteur, il fallait se
distancier du pinochétisme. Au début, personne ne voulut
(n’osa) le suivre. Le destin lui donna alors un coup de pouce : Pinochet
est détenu à Londres. La droite est alors dans la confusion
: Pinochet est absent pour longtemps et elle n’a pas de personnalité
charismatique à présenter aux élections. Sauf Lavin.
Comme il semble sa seule chance, la droite s’aligne derrière lui
avec armes et bagages, c’est-à-dire avec ressources matérielles
et financières, et accepte ses conditions : aucune mention de Pinochet,
pas de drapeaux des partis, le seul nom de Lavin sur la propagande. «
Lagos n’est pas Allende et Lavin n’est pas Pinochet », dit-il un
jour. Privilégiant le contact direct avec la population à
qui il promet tout ce qu’elle veut entendre, Lavin se présente comme
« un gérant qui résout les problèmes immédiats
des gens » et appelle à un grand « changement ».
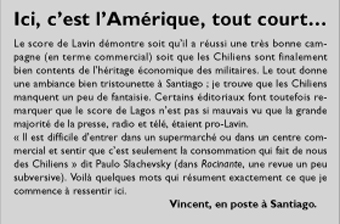
Les électeurs, libérés
de la polarisation Pinochet/anti-pinochétisme, optent pour le considérer,
non comme l’héritier du dictateur, mais comme l’homme du renouveau
d’une alliance politique concernée par les difficultés de
la population. La société chilienne a profondément
changé. Certains secteurs ont envie de pouvoir jouir des avantages
matériaux de l’ère de la consommation. D’autres pensent qu’il
peut apporter des emplois. Lavin promet une forte répression contre
la délinquance.
Lavin a su capter ces changements de mentalité
et les canaliser vers lui avec succès. La droite s’est rendue compte
que, si elle oublie un peu son général-idole et joue le jeu
démocratique, elle peut remporter des élections. Du coup,
elle envisage de fusionner tous ses partis en un seul, le Parti populaire,
qui accueillerait les transfuges de l’aile droite de la DC. Lavin (46 ans)
serait son indiscutable figure de proue pour les élections de 2006.
La Concertation aussi se rapproche du centre.
La DC sort renforcée et les secteurs militants (surtout socialistes)
perdent du terrain. Soledad Alvear, probable ministre de l’Intérieur
de Lagos, pourrait devenir la candidate présidentielle d’une Concertation
recentrée sur la DC pour les élections de 2006. Les partis
écolos, humanistes ou communistes ont été balayés
au premier tour et, bien que leurs militants ont voté utile pour
sauver Lagos, ils n’en retireront probablement aucun bénéfice.
Ici aussi, il est nécessaire de repenser (reconstruire) une opposition
qui redéfinisse ses utopies.
Qui c’est qui est heu-reuse, c’est la Bourse
!
Pour bien montrer ce qu’elle pense du «
socialiste » Lagos, la Bourse a gagné quelques points le lendemain
des élections. Le libéralisme n’a rien à craindre
: le futur cabinet économique de Lagos compte deux professeurs d’économie
à Harvard et deux économistes qui se sont opposés
aux réformes des lois du travail présentées par le
gouvernement juste avant les élections (et rejetées par un
vote massif de la droite). En attendant, la population attend de lui qu’il
n’oublie pas le passé («Que Pinochet soit jugé »
scandaient les 30 000 personnes venues écouter le premier discours
du nouveau Président), mais que le gouvernement, dans le futur,
mette autant d’énergie pour aider les petites gens qu’il n’en a
mis à développer la macroéconomie. « J’ai entendu
ce que vous avez dit » cria Lagos comme un écho du «
Je vous ai compris » de qui vous savez… On aurait tendance à
dire que rien n’a changé : même système, même
Concertation, même opposition, un général demi-gâteux
à l’hôpital (ça c’est nouveau !), les mêmes bas
salaires (pas pour tous !), les mêmes flics et les mêmes galonnés,
les mêmes arnaques du patronat. Avec Lavin, on aurait eu un peu plus
de tout cela. Avec Lagos, on aura peut-être, oooh, une légère
amélioration, de quoi maintenir les syndicats et les organisations
communautaires et populaires silencieux, comme depuis trop longtemps…
Jac Forton. — correspondant à Santiago
de Visages d’Amérique Latine (Radio Canut, Lyon) pour le Monde Libertaire.
NDLR : L’auteur a écrit le livre
« 20 ans de résistance et de lutte contre l’impunité
au Chili : 1973-1993 » édité par le CETIM/Genève.