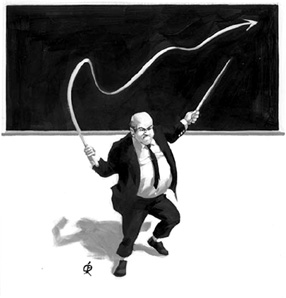Recherche publique : le capitalisme à
l’université
Gueule de bois dans le petit monde de la recherche.
Projets phares rayés d’un trait de plume, inquiétudes devant
la montée en puissance de l’intervention capitalistique dans le
secteur universitaire, démissions en cascade du Conseil National
de la Science, menaces sur les établissements publics de recherche
tels que le CNRS ou l’INSERM… il y a comme un malaise chez les chercheurs.
Certes, la fronde est pour l’instant essentiellement symbolique, et s’exprime
surtout sur le mode du refus de l’autoritarisme arrogant du ministre
et ancien collègue Claude Allègre : ainsi les démissions
de personnalités qui pensaient qu’un Conseil National de la Science
créé par et pour Allègre pouvait avoir une autre fonction
que celle d’entériner sans discussion toute décision ministérielle.
Mais c’est l’occasion de se poser quelques questions à propos de
la recherche scientifique, de son fonctionnement, de son contrôle
et de son financement.
La première question est de savoir
ce qu’est un chercheur (1). Si on s’en tient aux critères habituels,
la recherche relève essentiellement des Universités et des
établissements publics dont le CNRS est le plus connu. La recherche
privée reste assez marginale en terme d’emplois (cf. plus loin pour
les financements), et concerne essentiellement les applications industrielles
immédiates. Les chercheurs sont donc pour la plupart des universitaires,
dont l’activité de recherche n’est qu’un des aspects du travail
: ils sont également des enseignants (c’est leur rôle social
le plus voyant) et peuvent avoir des activités administratives,
les universités étant gérées à tous
les niveaux par les universitaires eux-mêmes (de l’organisation des
études à la présidence de l’Université).
On touche là d’ailleurs un des premiers
aspects du malaise actuel : la carrière d’un universitaire ne dépendant
guère que de sa productivité en tant que chercheur, l’investissement
pédagogique est, de fait, découragé, et une certaine
jalousie des enseignants-chercheurs envers les « privilégiés
» chercheurs à plein temps (personnels du CNRS de l’INSERM
secteur médical , de l’INRA secteur agronomique
…) est très perceptible. Jalousie sur laquelle Allègre
joue assez habilement dans sa tentative de démanteler ces organismes
trop autonomes à son goût.
La chasse aux crédits
Mais l’inquiétude principale porte
sur le financement de la recherche, et sur le « partenariat »
avec l’industrie, terme très porteur ces temps-ci. Cette idée
fait peur, parce qu’elle est lourde de menaces sur la recherche non économiquement
rentable à court terme, et aussi parce qu’elle suggère un
contrôle de la recherche par des gens non issus du sérail.
Qu’on envisage de renforcer fortement les pouvoirs des présidents
d’université, et de modifier leur mode d’élection pour renforcer
le poids du monde économique est de ce point de vue assez significatif.
D’ailleurs, le rapport Attali « pour un modèle européen
d’enseignement supérieur » est explicite : « Les entreprises
innovantes, qui créeront l’essentiel des emplois et des richesses
de demain, ne pourront se développer que dans une relation étroite
et confiante avec le système universitaire ». C’est la rengaine
du moment : sous le vocable très laid d’« incubateurs d’entreprises
», les universités sont dès à présent
invitées à se doter de véritables structures industrielles
et commerciales, notamment pour déposer et exploiter des brevets.
Autant dire que cette incitation à faire du « rentable »
fait grincer des dents, et suscite une grande inquiétude dans les
domaines de recherche sans débouchés financiers évidents…
mais qu’elle fait saliver les éventuels bénéficiaires
à qui on fait miroiter la double paie universitaire-industriel pendant
6 ans !
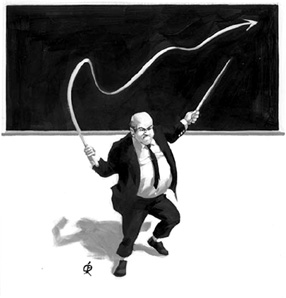
Mais il faut bien dire que, si cette évolution
existe, et est en effet préoccupante, le terrain a été
bien préparé, et depuis longtemps, par les universitaires
eux-mêmes. Il y a belle lurette que la course aux crédits
dans les laboratoires fait des ravages, et la « communauté
scientifique » n’a pas toujours rechigné à faire la
danse du ventre pour obtenir des fonds privés. Pour prendre un exemple
célèbre, la puissance financière de l’Association
de Recherche contre le Cancer a fait taire bien des réticences chez
les scientifiques dont les crédits dépendaient étroitement
de la « générosité » de Crozemarie. D’une
manière générale, on peut dire que les grands principes
s’amenuisent à mesure que les espérances financières
se précisent.
Dans le même ordre d’idées, les
problèmes éthiques sont assez facilement mis sous le boisseau
quand l’occasion se présente. Les chercheurs dont les travaux intéressent
l’armement ou les marchés financiers ont souvent le scrupule discret
; idem sur les applications de la recherche en psychologie ou sociologie
à la "gestion des ressources humaines" (comment briser toute velléité
de contestation sur le lieu de travail) ; et comme le fait remarquer le
récent éditorial de la revue « La Recherche »,
peu de spécialistes sont montés au créneau sur la
question du « principe de précaution » en matière
d’agrobiologie (on ne mord pas la main qui vous nourrit) ; pire, beaucoup
s’assoient sans scrupules sur ce principe de précaution appliqué
aux thérapies géniques à l’occasion des prestations
de mendicité télévisuelles comme le Téléthon
: il est clair que la perspective d’une conséquente manne financière
caritative n’incite pas à la pudeur ! Quant à faire la grève
des recherches, ou à abandonner un thème à cause de
ses éventuelles applications nuisibles, il n’en est évidemment
pas question (2).
Quand les scientifiques sont interpellés
sur les potentialités néfastes de leurs recherches, ils utilisent
le plus souvent deux lignes de défense : soit ils revendiquent une
recherche « pure » et « non salissable » (cas typique
des mathématiciens), soit ils clament leurs grands dieux qu’ils
n’ont pas voulu ça, que ce sont des applications auxquelles ils
n’ont aucune part et sur lesquelles ils nient toute responsabilité.
Si les exemples ci-dessus (ont pourrait en sortir des dizaines) montrent
la légèreté du deuxième argument, le premier
n’est pas satisfaisant non plus, posant la question de l’utilité
sociale de recherches inapplicables.
Vers un vrai service public de recherche ?
Car c’est finalement là qu’il faut
porter le débat. Qui décide de quelles recherches, et pour
quoi en faire ? Dans la mesure où la recherche est essentiellement
publique, c’est bien d’un problème de conception, d’organisation
et de contrôle d’un service public qu’il s’agit.
Le problème de la définition
des programmes de recherche et des priorités à retenir est
certainement trop complexe pour être réglé en quelques
lignes. Notons seulement que la recherche est par nature accessible essentiellement
aux spécialistes, lesquels ont donc largement leur mot à
dire sur l’intérêt intrinsèque ou les potentialités
de tel ou tel domaine. Mais comme les spécialistes ne sont eux-mêmes
à l’abri ni d’erreurs dans les perspectives, ni de conflits d’intérêts,
il importe de laisser une assez large autonomie « à la base
» pour les chercheurs.
En revanche, la collectivité peut tout-à-fait
définir des grandes priorités sur lesquelles mettre des moyens
conséquents, et contrôler l’utilisation des moyens en question.
Ce que l’on pourrait caricaturer en suggérant un transfert massif
des crédits de recherche intéressant les militaires et l’industrie
de l’armement vers la recherche en santé publique, quitte à
organiser un Arméthon tous les ans avec appel régulier à
la charité pour financer les progrès technologiques de l’armée
de demain…
D’une manière plus générale,
la recherche publique ne sera effectivement un service public contrôlable
par le public en question que si elle s’inscrit résolument en faux
contre la dérive capitaliste qui la guette actuellement. Ce qui
peut se faire en revendiquant ce qui devrait être la caractéristique
de tout service public : la gratuité. Vaccins gratuits, molécules
gratuites, utilisation libre et gratuite de brevets et de logiciels (c’est
déjà le cas pour certains d’entre eux). La recherche est
financée par la collectivité, que ses produits soient à
la disposition de la collectivité ! C’est probablement la seule
revendication qui, aujourd’hui, puisse vraiment battre en brèche
une vision marchande de la recherche qui a le vent en poupe. Et lutter
sur ces bases aurait, pour les chercheurs, une autre gueule que de s’inquiéter
de la part de gâteau qui leur reviendra. Reste à savoir s’ils
en ont la volonté…
COQ’S
(1) « un » chercheur… si
je garde ce masculin abusif par souci de lisibilité dans le reste
de l’article, c’est aussi l’occasion de souligner que la profession est
très majoritairement masculine, surtout dans les sciences dites
« dures ». Et qu’il serait probablement édifiant de
comparer le ratio de thèses soutenues par des femmes à celui
de femmes recrutées sur des postes fixes après leur thèse
pour évaluer le sexisme ambiant.
(2) À ma connaissance, le seul
scientifique « de poids» à s’être sérieusement
posé la question est Yves Testard, spécialiste de la procréation
artificielle. Aujourd’hui, il poursuit des recherches toujours aussi problématiques
en termes d’éthique…