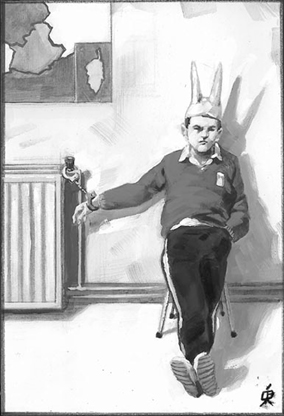Violence à l’école : toujours
plus de sécuritaire
dans un monde de brutes
Vols, rackets, persécutions, insultes,
agressions, grève de profs et parents d’élèves… Les
dernières recrudescences de violence dans les établissements
scolaires ont remis ce débat sur la table, récurrent quand
les médias n’ont rien à se mettre sous la dent. Alors nos
chères têtes blondes auraient-elles perdu la raison ? En tous
cas, depuis 1998, la violence à l’école est une priorité
du ministre de l’Éducation nationale Claude Allègre, qui
devait présenter la seconde partie de son plan gouvernemental de
lutte contre la violence, très attendu par la presse, les parents
d’élèves et les enseignants.
Du personnel précaire pour améliorer
les choses…
Le ministre a commencé par créer
cinq nouvelles zones prioritaires : Lille, Versailles, Rouen, Toulouse
et Strasbourg, ce qui fait une soixantaine d’établissements du second
degré supplémentaires environ. En ce qui concerne le manque
d’effectifs (enseignants, infirmières, médecins scolaires,
surveillants…), presse écrite et radios pronostiquaient la création
de 20 000 aides-éducateurs. En réalité, les chiffres
ministériels sont bien en deçà des espérances
: en effet, ce sont 7000 postes qui vont être créés,
parmi eux 4000 aides-éducateurs, et seulement 100 infirmières,
800 surveillants et 100 CPE. Grande nouveauté : les ATOS (Agent
technique ouvrier et sanitaire) seront remplacés par 2000 emplois-jeunes
ouvriers, recrutés à niveau CAP-BEP. Et point de postes d’enseignants
!
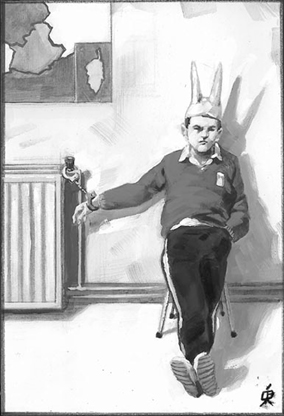
Malheureusement, depuis de nombreuses années,
professeurs et élèves font grève et manifestent contre
le sous-effectif de ces premiers, les non-remplacements de professeurs
absents, les classes surchargées, tous ces facteurs qui rendent
les conditions de travail des uns et des autres impossibles et survoltées.
Mais la priorité est donnée à la création de
ce nouveau type de travailleur social qu’est l’emploi-jeune, afin de venir
en aide aux équipes pédagogiques déjà sur place.
Le ministre assure que, cette fois, ceux-ci recevront une formation appelée
« médiation/contact » afin de réagir au mieux
une fois confrontés aux situations de violence. Les premières
réactions de professeurs et d’élèves ne se sont pas
faites attendre et soulignent que le manque de surveillants et de personnels
administratifs fait que, bien souvent, les aides-éducateurs sont
relégués à remplacer ce personnel manquant (surveillance
de la cour, de la cantine, aide aux devoirs, papiers administratifs…).
Ceci est d’une part en grande partie contraire à leur convention,
et d’autre part les empêche de travailler au projet pédagogique
qu’ils s’étaient fixé et pour lequel ils ont été
embauchés. Mais l’avantage est que c’est un personnel très
flexible, disponible pour boucher tous les trous, et qu’en plus, c’est
la seule catégorie d’emplois-jeunes dont le poste ne sera pas pérennisé
à la fin de ses cinq ans de bons et loyaux services. Alors que demander
de mieux ! L’ensemble du corps enseignant déplore également
que sous un préavis d’une semaine ou deux les emplois-jeunes peuvent
quitter leur poste s’ils ont trouvé un emploi stable, pour être
remplacé par un nouvel aide-éducateur avec qui il faut reprendre
tout le travail de formation.
Prévention et répression sont
dans un bateau, prévention tombe à l’eau…
Le second volet de ce plan de lutte contre
la violence à l’école concerne l’amont du problème
: la petite école. Sur ce terrain, Claude Allègre propose
le retour en force de l’enseignement de la morale et de la citoyenneté
à l’école. Ainsi, depuis septembre 98, des élèves
de classe de seconde ont 16 heures annuelles d’Enseignement d’Éducation
Civique Juridique et Sociale, assurées non pas par des enseignants
supplémentaires, mais par les profs d’histoire-géo à
80 % des cas. C’est apparemment chaque prof qui décide de quoi il
va traiter avec ses élèves, et cela semble être plus
un espace de discussion et de réflexion qu’un cours formel. Pour
ce qui est de l’apprentissage de la morale, le ministre a été
avare de détails, on ne sait encore ni ce qui sera au programme,
ni comment vont réagir les profs qui retombent 50 ans en arrière
(pourquoi pas du catéchisme tant qu’on y est pour apprendre à
respecter son prochain !).
Un autre grand slogan de ce plan de lutte
contre la violence est la « justice scolaire », qui se traduira
à la fois par l’établissement d’une échelle de sanctions
scolaires et de punitions disciplinaires que pourra pleinement appliquer
le conseil de discipline (jugé jusque-là incompétent
car ne pouvant faire appliquer que les renvois supérieurs à
huit jours) et également l’application des principes généraux
du droit à l’école (sanctions et procédures écrites
dans un règlement intérieur qui sera le même pour tous
les établissements ; possibilité pour l’élève
de se défendre ; proportionnalité et individualisation des
sanctions). Encore une fois, il s’agit de rendre plus efficace le système
de sanction, calqué sur le modèle d’un tribunal scolaire,
alors que ce qui était attendu était de s’attaquer aux racines
sociales de cette violence.
Et pour couronner le tout, Allègre
a décidé de faire plaisir à Chevènement, lequel
déclarait qu’il fallait « des sanctions sévères
» à l’encontre des phénomènes de violence. Chose
promise, chose due : sa police de proximité pourra donc patrouiller
aux abords de 75 lycées très sensibles, voire intervenir
à l’intérieur quand une altercation dégénère.
On peut présager que ceci n’augure rien de bon et que la présence
de policiers va en certains endroits encore plus accroître les tensions
et non pas régler les problèmes.
Expression d’un mal-être général
Au-delà des déceptions provoquées
par ce plan, une chose intéressante ressort de ces débats
autour de la violence à l’école : tout le monde est conscient
que celle-ci est poreuse aux violences du monde extérieur, et que
ce qu’il s’y passe est le symptôme et le révélateur
d’un mal-être chez les jeunes en général. Le fait est
que l’on vit dans un système violent dans son ensemble, où
le mythe de l’école de l’égalité des chances est balayé
par les réalités économiques et sociales don tout
le monde a conscience (chômage, précarité, compétitivité,
racisme et discriminations, intolérances…). Au final, ce plan de
lutte contre la violence à l’école, attendu et monté
en épingle par de nombreux médias, est un flop complet. Allègre
pense que précarité et sécuritaire vont endiguer le
phénomène, il en est le seul convaincu. Même si ce
type de mesures existaient déjà, elles ont au moins le mérite
de mettre en valeur la personnalité déjà très
critiquée du ministre, qui apparaît encore plus comme un homme
autoritaire, qui veut que l’on fasse la morale à l’école
et qui veut gérer les causes sociales de la violence par encore
plus de sécuritaire. Qui respecte qui dans tout ça ?
Séverine. — groupe Jules-Vallès
(Grenoble)
« Violences scolaires : Claude
Allègre ajourne le traitement de fond », Le Monde du
28 janvier 2000, p. 9.
« Les débuts chaotiques de
la nouvelle instruction civique », Le Monde du 27 janvier
2000, p. 9.
« Face aux violences, Claude Allègre
veut renforcer la discipline scolaire », Le Monde du 23-24
janvier 2000, p. 7.