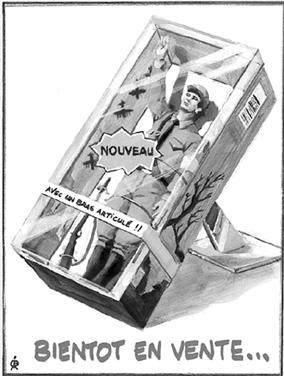2030, odyssée du capitalisme
Les conséquences de la décomposition
de l’empire soviétique, l’événement majeur de la fin
du XXe siècle, sont encore incalculables. Mais elles sont d’ores
et déjà fondamentales. Plus rien n’est comme avant. Le bolcho-stalinisme
apparaît déjà comme une sorte de parenthèse
historique, longue, brutale, sanglante, effarante, mais parenthèse
quand même face à un libéralisme victorieux sans ennemi
reconnu. Tout se passe comme si le monde était retourné à
la situation d’avant la révolution russe. Bien sûr, le début
de l’an 2000 n’est pas totalement identique à 1917. Mais le rapprochement
est parfois troublant. Peu ont manqué de rappeler l’analogie entre
Sarajevo 1914 et Sarajevo 1994, trop curieuse pour n’être qu’une
simple coïncidence.
Ce qui est issu de la boucherie de 1914-1918,
c’est le capitalisme d’État sous trois formes : démocratique,
fasciste et stalinien. Le premier est libéral. Les deux autres ne
le sont pas. La première guerre mondiale a balayé les restes
des anciens systèmes monarchiques, déstabilisé la
déjà vieille bourgeoisie conservatrice et tué le syndicalisme
révolutionnaire, laminé par l’Union sacrée dans les
pays occidentaux et par le bolchevisme en Russie.
Fascisme et stalinisme ont constitué
des formes abouties du capitalisme d’État. Le premier s’est autodétruit
et a été détruit en 1945. Le second eut une vie plus
longue, et il perdure de nos jours sous certains aspects (Chine) et en
quelques endroits (Corée du Nord, Cuba). Tous les deux sont indissolublement
liés à la révolution russe : l’un étant sa
réaction (le fascisme), l’autre son prolongement (le stalinisme).
L’apparition du capitalisme d’État sous ces deux formes radicales
a, dans une large mesure, modifié la course d’un capitalisme libéral
qui, sans cela peut-on supposer, aurait suivi une trajectoire différente.
Retour à 1917-1922
La plupart des observateurs de bonne foi ont
souligné le paradoxe que constitua le triomphe d’un État
marxiste-léniniste dans une Russie largement rurale et arriérée,
alors même que, conformément à leur schéma du
matérialisme dialectique historique, Marx et Engels présupposaient
mécaniquement la consécration d’un communisme d’État
dans les pays où le capitalisme industriel aurait atteint son stade
de maturation contradictoire. Ce prélude était considéré
comme objectivement indispensable pour passer à l’étape suivante
du mode de production communiste. En outre, autre paradoxe sur le plan
théorique, Marx, Engels et les marxistes, proclamaient, non sans
raisons, que c’est l’économie qui gouverne le monde. Mais, dans
la pratique, la mainmise de Marx et Engels sur la première Internationale
et l’arrivée putschiste au pouvoir de leurs épigones, en
Russie puis ailleurs, ont montré que c’est le politique qui décide
de tout là où ils règnent !
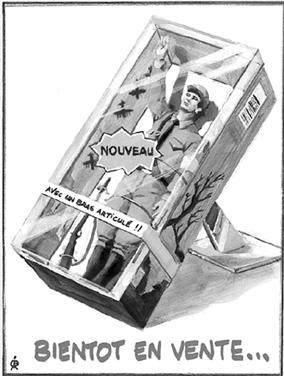
Bakounine qui dénonçait
à la fois le mythe mécanique marxiste, son utilisation dictatoriale
par les marxistes au sein de la première Internationale et la dictature
des gourous sur celle-ci, eut donc triplement raison. Mais cela n’a pas
suffit, l’histoire se moque de la raison. Quant à Proudhon, il critiquait
de façon anticipée la théorie marxiste de la paupérisation
absolue du prolétariat, en annonçant lucidement l’émergence
des classes moyennes. L’histoire socialiste lui ria au nez.
Se positionnant tous les deux vis-à-vis
du socle socialiste, mais contre le réformisme ou la tiédeur
de celui-ci, les mouvements léninistes et fascistes se sont distingués
par leur considération différente de l’idée nationale,
du moins dans un premier temps, car ils ont pratiquement fini au même
point. Le léninisme, qui s’afficha pour l’internationalisme dit
prolétarien, au moins par fidélité au slogan de la
Première internationale « Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous», aboutit à une défense étroite
et sectaire du pré carré russe sous Staline, coûte
que coûte. Le fascisme, qui revendiqua au début un socialisme
national, déboucha ensuite sur un impérialisme hystérique.
En politique comme en économie,
léninisme et fascisme ont finalement adopté la même
attitude, s’appuyant sur des forces sociales et des discours qui n’étaient
pas toujours différents (premier programme des Faisceaux en 1919,
nazis et communistes faisant ensemble le coup de poing contre les socio-démocrates
à la fin des années 1920 en Allemagne). Les deux ont prôné
l’industrialisation lourde, le machinisme et le taylorisme. Les deux ont
combattu le syndicalisme libre et indépendant, même si leur
tactique antisyndicale utilisa des moyens différents.
Les leaders eux-mêmes, Mussolini et
Lénine, qui se sont d’ailleurs rencontrés, ont d’abord mené
tous les deux une stratégie politique assez semblable au sein de
leur parti socialiste respectif : la recherche d’une rupture avec l’aile
modérée. Même si Mussolini échoua là
où Lénine réussira, il semblait sur la bonne voie
lorsque, en 1912, il se fit nommer directeur du quotidien du Parti socialiste
italien, et qu’il fit adopter à celui-ci une position révolutionnaire.
Cela fait d’ailleurs dire à l’historien Ernst Nolte que «
Mussolini fut le premier communiste européen de l’époque,
et même, d’un certain point de vue, le seul».
Retour à 1933
Après la première guerre mondiale,
la capitalisme a connu un second soubresaut, la crise de 1929, qui a fait
basculer le fascisme italien du libéralisme en économie vers
l’étatisme et l’interventionnisme, voie que le nazisme adopta. En
Union soviétique, Staline lança le plan quinquennal et affama
dramatiquement les campagnes, causant des millions de morts. Dans les démocraties
occidentales, le compromis dit fordiste finit par l’emporter, sur fond
de New Deal et d’interventionnisme étatique en économie et
dans les relations travail-capital. C’est le triomphe du capitalisme d’État
qui culminera au cours des Trente Glorieuses.
De nos jours, si l’on excepte le cas de la
Chine, et encore, le capitalisme d’État bat de l’aile. Le «
soviétisme » est liquidé. Le compromis fordiste est
remis en cause par le patronat, tandis que les bureaucraties syndicales
recherchent désespérément du grain à moudre.
Les partis communistes occidentaux se sont social-démocratisés,
plus ou moins vite, plus ou moins profondément selon les pays, de
concert avec la droitisation des partis socio-démocrates. L’écologisme
garde deux fers au feu : un écofascisme politiquement cafouilleux
mais idéologiquement puissant ; un écomollisme social-démocrate
arrivé au pouvoir par des coalitions (France, Allemagne), inefficace
contre le productivisme capitaliste et reniant jusqu’à ses fondements
pacifistes en légitimant l’intervention de l’OTAN dans les Balkans.
C’est dans ce contexte que se sont opérées en Europe la renaissance
du néo-fascisme puis sa transformation en post-fascisme. Le processus
est devenu chaotique en France, mais il s’est accompli avec succès
en Italie (interrompu pour le moment) et en Autriche. Ailleurs, en Belgique,
en Suisse, ou dans d’autres pays sous d’autres formes, il se poursuit.
Le post-fascisme puise ses forces vives dans
la petite-bourgeoisie, souvent rurbaine, une partie de la classe ouvrière,
auprès des petits chefs d’entreprise, des commerçants, des
cadres moyens, bref des «petits» en tout genre qui sont effrayés
par la mondialisation, c’est-à-dire par les conséquences
que celle-ci a sur eux et pour eux : concurrence économique des
multinationales, immigration jugée menaçante, cosmopolitisme
bourgeois américanisé vécu comme déstabilisant,
voire déculturant, critique de la démocratie corrompue.
Le post-fascisme réclame l’État
sécuritaire et l’homme fort, pour remettre de l’ordre, restaurer
la nation, ré-embellir les paysages (sociaux, culturels : propres,
sans immigrés ni pollutions), tout en critiquant l’État bureaucratique
et social (pour les autres, pas pour eux). Il promet tout et son contraire
suivant l’interlocuteur auquel il s’adresse, exactement comme le fascisme
dans les années 20 ou 30.
Ce n’est pas tout. Son appel à plus
d’État recouvre objectivement celui des forces placées ailleurs
sur l’échiquier politique (communistes radicaux, chevénementistes,
gauchistes, gaullistes historiques, souverainistes…), qui demandent le
retour d’une nation, c’est-à-dire d’un État (ou réciproquement
suivant les clivages), solidaire, fort, anti-américain ou anti-européen.
Ce substrat socio-culturel favorise sur le fond le post-fascisme, même
démonisé. Il dépasse ses propres forces politiques,
ce qui est à terme le plus dangereux.
Retour au libéralisme en économie,
petite-bourgeoisie déstabilisée, droitisation de la gauche,
renouveau du nationalisme et des intégrismes, montée de l’extrême
droite, démission de nombreux intellectuels, résignation
d’une grande partie du peuple : presque tous les ingrédients explosifs
des années 1930 sont là de nos jours, mais sans le bolchevisme
et avec, par contre, des éléments d’avant 1917. C’est un
mélange des deux. Le début du nouveau millénaire a
un goût amer de 2030. Comme après la première guerre
mondiale, comme après la crise de 1929, le capitalisme est à
la recherche, sous peine de disparaître, de ses propres formes de
régulation, quitte à recycler des idéologies qui lui
sont apparemment opposées.
L’Europe reste le laboratoire de bien des
processus actuels car c’est là que la classe ouvrière est
encore, malgré tout, la moins mal organisée et la plus «politisée».
Si l’on ne doit pas être dupe du battage médiatique fait autour
de Jorg Haider, alors que les médias sont restés bien silencieux
quand des ministres post-fascistes arrivèrent au gouvernement Berlusconi,
les événements d’Europe occidentale sont indiscutablement
inquiétants. Il est possible que, face au mouvement encore confus
des anti-OMC, anti-Seattle et anti-Davos, les grands dirigeants internationaux
jouent la carte du post-fascisme (racisme softisé, xénophobie
variable, caractère de masse édulcoré, régional-localisme
ronflant, BCBG), en laissant aux politiciens avariés les cries d’orfraie
de la démocratie bafouée.
Il n’est pas sûr que ceux qui en appellent
à un meilleur contrôle de l’État sur l’économie,
à la taxe Tobin, aux écotaxes, ou au mangeons-bien-de-chez-nous-en-regardant-des-films-exception-culturelle,
ne se fassent pas alors, bien malgré eux, les adjuvants de ce processus.
Un quelconque néo-bolchévisme ayant peu de chances d’émerger,
c’est la vieille issue culturalo-nationaliste potentiellement fasciste
qui demeure.
Echapper à cette tournure semble
bien difficile car le mouvement révolutionnaire, empêtré
dans son sectarisme et ses schémas dépassés, a peu
de choses à offrir aux populations désemparées. Le
nier serait revenir à l’époque où il ne fallait surtout
pas critiquer la «patrie du socialisme» ni la «ligne
du parti». La tragique désillusion engendrée par le
bolchevisme, avec ses espoirs déçus pour longtemps encore,
la déconvenue suscitée par la politicaillerie écolo
ainsi que la légitime méfiance envers tout discours pré-cuits
et le sectarisme militant sont vivaces. Avec une remise en cause sincère
sortie de la langue de bois, le présent est à construire,
sans attendre un autre futur.
Philippe Pelletier. — groupe Makhno de Saint-Etienne