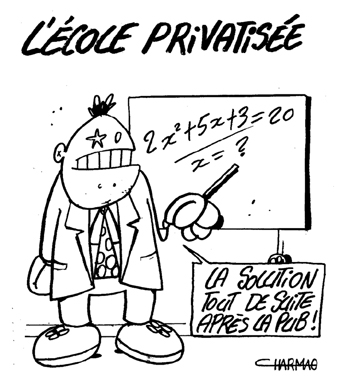Sur l’avenir de nos établissements
d’enseignement
A l’heure où le ministre en charge
de l’Éducation nationale réintroduit au lycée des
cours de « morale civique » au seul motif que le « pacte
républicain » se délite et que trop de jeunes aujourd’hui
méconnaissent ou ignorent les principes fondamentaux sur lesquels
reposent la communauté toute entière, il n’est pas inutile
de dresser un constat de l’état du système éducatif
et de le mettre en perspective à partir des réformes orchestrées
par ce même ministre pour soi-disant améliorer, rénover,
moderniser l’école de la République. Ici, un seul mot d’ordre
prévaut : déconcentrer.
La déconcentration, en effet, se veut
être une décentralisation de la politique de gestion du système
éducatif. Elle consiste en un transfert des compétences et
des pouvoirs qui, jusqu’à présent, dépendaient du
seul ministère vers les rectorats d’académie (région),
lesquels répercutent sur les inspections d’académie (département),
et les établissements scolaires (ville). Médiatiquement justifiée
par le ministre comme « un dégraissage du mammouth »,
et à seule fin de rendre plus accessible la privatisation du secteur
public.
Une privatisation rampante et une marchandisation
des savoirs
Décentraliser les modes de financement
représente évidemment une priorité. La déconcentration
budgétaire est la mesure la plus inquiétante. Elle tendra
inévitablement à terme (réduction des dépenses
publiques oblige) à contraindre et donc à inciter les régions
à chercher des partenaires financiers dans le secteur privé.
Seuls de grands groupes (Banques, assurances, Aerospatiale, Rhône-Poulenc,
Vivendi, Matra, Bouygues, etc.) seront en mesure de doter les régions
d’enveloppes suffisamment conséquentes pour se substituer au désengagement
de l’État. Déconcentrer revient ici sinon à privatiser,
du moins à rendre possible le jeu de la concurrence et du marché
dans le système éducatif (primaire et secondaire), comme
cela est déjà le cas dans l’enseignement supérieur.
De récentes affaires ont montré combien les entreprises étaient
à l’affût de la moindre faille pour s’introduire dans le milieu
éducatif, quand ce n’est pas celui-ci qui se révélait
perméable au marketing des multinationales : valises pédagogiques
offertes par Kellogg’s, ensemble d’initiation à l’euro distribué
par Leclerc, etc. Les grandes marques ont su saisir au vol une telle opportunité
d’être à la fois les interlocuteurs et les partenaires privilégiés
de l’Éducation nationale certes, mais aussi évidemment de
toucher un jeune public qui sera à terme un consommateur à
part entière.
La « nouvelle économie »,
comme se plaisent à la nommer aujourd’hui les analystes financiers,
n’est pas en reste pour s’introduire dans le système éducatif
via les logiciels pédagogiques utilisés en classe, ou bien
encore via des sites Internet exclusivement dédiés à
l’enseignement. Moyennant un abonnement prohibitif, il est ainsi possible
d’accéder à de véritables cours particuliers «
en ligne », comprenant leçons, exercices, devoirs, corrigés.
Outre le fait que ces prestations ne sont accessibles qu’aux foyers ayant
les moyens de se les payer accroissant encore un peu plus les inégalités
, il est manifeste que le développement particulièrement
fulgurant de ces « start-up » qui font de l’éducatif
leur domaine réservé, s’apparente à une anticipation
du système privé et concurrentiel pour mieux se substituer,
à terme, au service public.
Compte tenu de l’état préoccupant
du système scolaire, des récentes mesures prises par le gouvernement
pour soutenir le développement des entreprises vouées exclusivement
au multimédia et au réseau mondial, des déclarations
intempestives de C. Allègre dont l’objectif affiché est de
développer l’enseignement par ordinateur au point de rendre la présence
d’enseignants facultative, l’avenir de l’école en général
est sombre quant à ses possibilités de demeurer un service
public gratuit, offrant à tous des conditions de travail de qualité.
Un contrôle accru et une précarité
toujours plus affirmée
Le transfert des compétences de Paris
vers les régions est aussi très significatif pour peu qu’on
le rapproche de mesures comme celle visant à favoriser l’apprentissage
des langues régionales, ou bien encore du nouveau contrat État/région
qui prévoit (dans le texte !) la priorité à l’emploi
pour les personnes issues de la région elle-même, une forme
de droit du sol régional au relent éminemment fascisant.
Ceux qui voient là une victoire dans la reconnaissance de qui le
breton, qui l’occitan, qui le basque, etc. oublient, au passage, que la
motivation première de telles mesures est de flatter le repli identitaire
latent dans l’ensemble du pays pour mieux faire passer le morcellement
du service public et multiplier ainsi les différences d’une région
à une autre, en accroître les spécificités comme
pour mieux justifier (rétrospectivement) le bien fondé d’une
telle mesure. Cela permet surtout, on l’aura compris, de rendre plus difficile
des mouvements de contestation et de lutte, dont le caractère général
n’aura plus lieu d’être compte tenu de la diversité des situations
et des politiques des régions. La simple défense d’«
un service public d’enseignement », par exemple, sera rendue caduque
par l’existence non plus d’une mais de plusieurs politiques d’éducation.
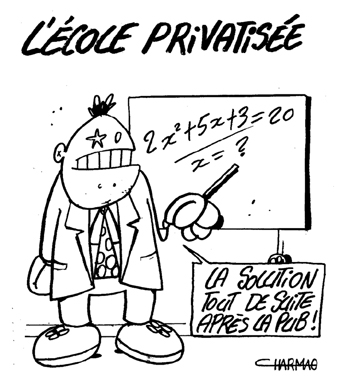
Le mouvement du personnel titulaire, le recrutement,
le financement, l’évaluation des enseignants sont directement ou
plus sournoisement visés par cette mesure. Elle donne les pleins
pouvoirs aux régions pour gérer selon leurs besoins les effectifs,
les affectations, et les ressources financières pour construire,
rénover, agrandir les établissements scolaires. L’apparition
depuis 2 ans d’un statut hybride dans le corps enseignant, le « titulaire
sur zone de remplacement » (professeur titulaire sans affectation
sur un établissement sinon simplement administrative
mais sur une vaste zone géographique) était en quelque sorte
le premier volet de la déconcentration, en ce qu’il introduisait
officiellement une flexibilité et une mobilité au niveau
du personnel éducatif. La déconcentration doit se lire aussi
à partir des projets de lois visant à accroître le
rôle et les pouvoirs du chef d’établissement, ainsi qu’à
modifier les processus d’évaluation des enseignants. En effet, à
l’heure où le discours dominant tend à vouloir éliminer
le statut des professeurs à des professions libérales ou
au secteur privé (c’est-à-dire là où le salaire
est conditionnel de l’obligation de résultat), le risque est de
voir apparaître très vite des pratiques de titularisation
en fonction des résultats d’une classe par rapport à celle
de l’année précédente, ou de quotas fixés d’une
année sur l’autre. Ici, tous les scenarii sont possibles !
Le personnel éducatif n’est pas le
seul à subir les effets de la politique actuelle. La précarité
des personnels et agents techniques est là encore parlante, même
si elle ne bénéficie pas d’une médiatisation aussi
large que celle des enseignants. L’Éducation nationale emploie un
nombre vertigineux de C. E. S, dont les conditions de travail, d’embauche
et de rémunération révèlent le mépris
dont ils font l’objet. Occupant des postes nécessaires pour le bon
fonctionnement des établissements, autrement dit de véritables
emplois statutaires, ils servent seulement à panser les plaies de
plus en plus béantes de ce que les chrétiens de gauche et
les jacobins progressistes nomment non sans fierté et soumission
« l’École de la République ».
La volonté de l’État de maintenir
et de développer une précarité et une flexibilité
à tous les niveaux de compétence fut stigmatisée (cela
fera bientôt 3 ans) par le recrutement des emploi-jeunes. En décembre
dernier, ils étaient près de 80 000 disséminés
à tous les niveaux du système éducatif, du primaire
au supérieur. Si certains sont employés sur des postes laissés
vacants par le non renouvellement du personnel, force est de constater
que leur statut particulièrement flou autorise tous les abus (la
formation à laquelle ils ont droit se fait toujours attendre, par
exemple) et toutes les dérives. La plus dangereuse et forcément
la plus pernicieuse étant qu’au terme des 5 années de travail
dans un établissement, leur présence qui au départ
était embarrassante (« Que vont-ils faire ? » était
la question qu’on entendait dans toutes les bouches) est rendue comme nécessaire.
Les syndicats l’ont bien compris, eux qui se battent à présent
pour maintenir non pas le personnel mais le poste ! Ainsi sont-ils sur
le point d’obtenir de l’État l’assurance d’une pérennisation
de la fonction aux dépens du personnel qui, lui, changera tous les
cinq ans. L’exemple est remarquable en ce qu’il exhibe toute la nocivité
de la politique d’aménagement à laquelle s’emploient les
syndicats de l’enseignement qui, abandonnant la lutte contre les emplois-jeunes
(l’ont-ils seulement commencée ?) préfèrent être
les acteurs et les partenaires de leur nécessaire continuité.
La régression sécuritaire, comme
seule réponse
Ségolène Royal et Claude Allègre
viennent ces jours-ci de prendre des mesures pour lutter contre la violence
a l’école. Il est plus que significatif que cette problématique
reçoive comme principale réponse de l’État l’ouverture
des établissements scolaires aux forces de l’ordre public.
Cette réponse induit en effet que l’État
a définitivement fait le deuil d’une idée décisive
(dont il n’est pas à l’origine, puisqu’elle est le présupposé
fondateur de tout projet éducatif) : celle qui voulait que la communauté
scolaire soit capable en elle-même et par elle-même de répondre
et de régler les problèmes inhérents à une
vie en communauté, et ce précisément parce que cette
communauté était scolaire. Autrement dit, l’idée qu’à
partir de ce qui était son essence : l’apprentissage du savoir et
de la culture, pouvaient réellement se construire et s’établir
les principes d’un « en commun ». Cela n’est rendu possible
que pour autant que l’école soit vécue par les élèves
et élaborée par les enseignants comme un lieu où précisément
l’individu se réalise non pas à partir d’une dimension publique
mais privée, c’est-à-dire que son rapport au savoir et à
la culture ne soit pas préalablement identifié et formaté
à partir des besoins des exigences ou des injonctions immanquablement
idéologiques de la société, mais soit au contraire
le fruit de son désir d’apprendre et de connaître (1).
C’est donc au moment où l’école
en général ne parvient plus à contenir ce n’était
déjà pas son rôle les effets dévastateurs
d’une politique sociale proprement suicidaire, au moment où se révèle
l’impasse dans laquelle on conduit des réformes éducatives
ineptes, que la réponse gouvernementale prend les formes strictement
autoritaires et répressives de l’État policier.
Cette intrusion de la police nationale dans
l’école en dit long sur la teneur des priorités du gouvernement.
Il ne s’agit pas pour lui de s’interroger sur les conditions qui rendent
possible des actes de violence, y compris au sein de l’école. Il
s’agit encore moins évidemment d’y déceler l’ultime forme
d’expression de générations pour crier leur dégoût
et leur haine à l’égard d’une société qui les
opprime, d’une société privée de toute perspective
enthousiasmante et audacieuse y compris dans son projet culturel et éducatif
en un mot communautaire, sinon celle de se vendre et de faire du profit.
Non, rien de cela dans l’action gouvernementale de Jospin sinon de rassurer
l’électeur en lui balançant de l’ordre, et de mater le sauvageon
en lui lâchant ses chiens.
Cette mesure intervenant au moment où
le gouvernement continue de diminuer le nombre de postes aux concours de
recrutement en dépit de besoins toujours plus urgents où
la privatisation du secteur public suit son cours dans le domaine des transports,
de la communication, de la santé, l’heure n’est plus à l’aveuglement
ni à la myopie rassurante, aux indolentes illusions, ni même
au confort mensualisé.
Devant cette accélération fulgurante
de l’école marchande, l’atonie des syndicats traditionnels de l’enseignement
est significative du degré de compromission et de complicité
dont ils sont éminemment coupables. À trop vouloir jouer
le jeu du dialogue seule forme possible à leurs yeux pour
lutter intelligemment ils ne sont plus que les greffiers de luxe
du libéral fascisme à visage humain de la majorité
plurielle.
Pourtant, qu’on ne s’y trompe pas, la condition
préalable à toute résistance significative c’est-à-dire
susceptible de porter en elle une alternative se formule en un mot,
un seul : rupture.
Rodolphe Delcros (Périgueux)
(1) On lira sur le rapport « Sphère
publique-sphère privée » et sur son articulation avec
la question de l’autorité, l’analyse brillante et troublante par
son actualité d’Hannah Arendt, « La crise de l’éducation
» in La crise de la culture (Gallimard, folio essais).