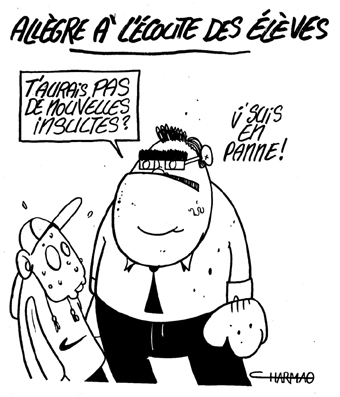Pourquoi l’école est-elle si dure ?
Cette question vaut pour les enseignants comme
pour les élèves car ni les uns, ni les autres ne maîtrisent
les règles de fonctionnement et les objectifs de l’école.
Sa dureté se trouve principalement dans le modèle frontal
expositif qui en est le centre depuis la création de l’école
de la IIIème République. Un modèle frontal au niveau
des savoirs puisque l’enseignant est chargé de transmettre des connaissances
que les élèves n’ont pas. C’est à partir de là
que s’est institué le rang d’élèves qui « suivent
» un cours fait par un professeur sur une estrade dans lequel les
élèves ne maîtrisent ni les objectifs, ni le sens,
ni le fonctionnement de ce moment. Si jamais ils pouvaient avoir prétention
à dire ce qu’ils veulent, on leur expliquerait que la science est
trop compliquée pour qu’ils en discutent et que la pédagogie
est l’affaire du professeur. Dans ce modèle frontal, les élèves
sont évalués sur des contrôles fréquents pour
les situer par rapport à une norme de la classe et une norme du
savoir. Le modèle frontal se retrouve aussi dans la discipline.
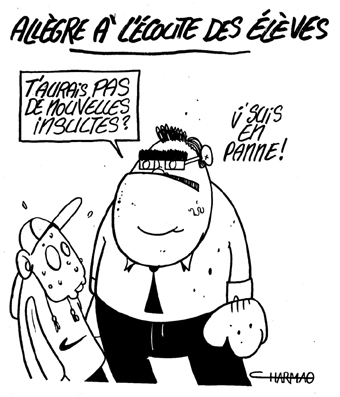
La philosophie de base est de penser l’élève
comme étant opposé à la connaissance et à la
situation d’enseignement. C’est d’ailleurs parce qu’il y est naturellement
opposé mais qu’il l’accepte tout de même que la situation
est intéressante en termes de socialisation car c’est bien ce qu’on
demande aux gens de faire toute leur vie, sauf s’ils dirigent. Ainsi, l’enseignant
doit organiser le contrôle constant des élèves qui
ne peuvent accepter de travailler que s’ils sont contraints. D’où
les tables dénudées qui permettent de voir ce que fait l’élève,
les fenêtres dans les salles et tout le dispositif qui est fait pour
assurer le contrôle comme l’a montré déjà Foucault
en faisant l’analogie entre la prison, l’asile et l’école. Lui comme
des sociologues américains comme Goffman parlent d’institutions
totalitaires pour les décrire. Une institution est totalitaire à
partir du moment où le temps et l’espace des personnes est décidé
par d’autres et qu’elle produit son propre système de pénalité.
L’emploi du temps est ainsi ce qui fixe les personnes dans des obligations
de temps et de lieu. Ce modèle frontal s’il a été
amendé par les pédagogies nouvelles et de nombreux penseurs
de l’éducation, dont nombres d’anarchistes, reste la clef de voûte
du système. L’école fonctionne comme une troupe dans laquelle
l’individu est fondu et qui est totalitaire.
Les élèves ont bien compris
que la critique était vaine. De toute façon, dans ce modèle,
un énorme soupçon pèse sur ce qu’ils peuvent penser
puisque l’élève est opposé à l’effort que demande
l’école. Sa parole est disqualifiée. Pourtant, notre société
développe énormément un discours du droit unilatéral
à la critique et de la concertation comme moyen légitime
d’assurer un ordre juste. Mais les univers comme l’école ou l’entreprise
sont pris à défaut par ce discours. Habitées par un
droit à la critique, les personnes font l’apprentissage de l’obéissance
et apprennent à se taire puisque la critique est vaine dans ces
univers. Dejours, un psychologue du travail, a bien montré que la
principale souffrance au travail réside dans le fait de ne pouvoir
la dire car le système est fondé sur le fait de taire cette
souffrance pour s’en accommoder et en arriver à la nier. C’est exactement
ce qui se passe au collège et au lycée où on n’arrête
pas de demander aux élèves de se comporter contrairement
à ce qu’offrent les situations dans lesquelles ils sont. «
Soyez autonomes, critiques » est le slogan de l’institution mais
sa pratique réelle s’y oppose.
Résister à l’obéissance
programmée
Il ne reste plus alors aux personnes, les
élèves en particulier, qu’à résister à
la situation scolaire. La résistance est une dimension fondamentale
de nos vies. Alors qu’on présente souvent, y compris en sociologie,
le monde social comme donnant le choix entre accepter et s’intégrer
dans une situation et lutter et critiquer dans une situation, on s’aperçoit
que les personnes peuvent rarement faire l’un ou l’autre. Peu de situations
nous amènent à nous engager pleinement (si ce n’est le militantisme
ou l’amour !) mais peu de situations nous permettent la critique. Alors
il reste à rester dans la situation, par exemple le cours au collège,
sans s’engager, ni critiquer mais en essayant de porter une critique non
publique et non assumée qui est le propre de la résistance.
Il reste aux élèves à
résister à l’emprise de la situation et à faire échouer,
sans l’assumer publiquement, l’action entreprise par le maître. La
résistance est donc ce mode qui vise à faire échouer
une situation tout en faisant peser la charge de la preuve sur ceux qui
dominent la situation.
Quand des élèves mettent vingt
minutes à faire un exercice prévu sur dix minutes comment
le maître peut-il savoir si cela relève d’une résistance
malveillante des élèves ou d’une réelle difficulté
non anticipée ? Quand des élèves bavardent tout en
assurant qu’ils parlent du cours, comment attester une intention malveillante
? Quand un élève est distrait, s’ennuie, rêve, regarde
par la fenêtre, écrit son courrier… le professeur peut-il
parler de résistance ? Quand une élève demande à
la professeure de refaire le précédent cours où elle
n’était pas, comment assimiler cela à de la malveillance
?
Cette résistance permet de nuancer
le poids de la domination. Il n’y a jamais de situation où les dominants
n’ont qu’à énoncer les principes de leur domination pour
dominer. Ils doivent toujours faire un difficile travail pour justifier
et mettre en place leur domination. Et s’ils doivent le faire, c’est parce
que nulle part les gens consentent à se laisser dominer sans résister.
Il n’y a que certains sociologues pour décrire la domination comme
étant tellement forte que les dominés souscriraient aux principes
de leur domination. L’école est un bon exemple de ce fait : si le
travail de domination était si facile, le boulot des enseignants
serait moins épuisant et les élèves ne souffriraient
pas de l’école. Au final, il est plutôt bon de constater cette
résistance à l’emprise des situations. Il faut affirmer qu’il
n’est pas possible de s’engager dans une situation de cours pendant six
ou sept heures par jours comme on le demande aux élèves.
C’est d’autant moins le cas si les dits élèves sentent bien
qu’ils font partie de ceux qui sont promis à goûter les plus
grandes nouveautés de notre société, emplois précaires,
humiliations au travail, chômage, RMI, vexations dans les services
sociaux, expulsions de son logement, racisme au quotidien….
La violence, c’est d’abord l’institution
Pour contrer cette résistance, l’institution
peut user de plusieurs moyens. Le plus sympa et le plus ancien est de développer
une pédagogie qui fasse que l’élève dépasse
sa résistance pour s’engager dans la situation. Vieille lune de
professeurs qui fait culpabiliser tous les enseignants quand on sait que
les professeurs ne maîtrisent pas ou si peu ni les programmes, ni
les méthodes, ni le dispositif de la classe. Soit l’institution
peut tenter de durcir la situation et de ne pas accepter cette résistance.
C’est alors que commence une extension de la notion de résistance
à la notion de violence. C’est d’autant plus le cas dans les établissements
qui accueillent des publics défavorisés toujours suspects
d’être très éloignés de l’école.
Tout devient violence et c’est alors qu’on
nous sort le topo sur l’incivilité. Suivant en cela la théorie
de la vitre cassée qui estime que pour éviter les grands
actes délictueux, il faut être dur avec les petits actes délictueux,
l’institution scolaire assimile aujourd’hui le vol de trousse à
un acte qui demande un signalement au procureur. La confusion entre la
résistance et la violence sert évidemment un discours sécuritaire
qui est l’équivalent pour l’école de ce que Wacquant appelle
le passage de l’État social à l’État pénal.
Une certaine criminalisation est à l’œuvre aujourd’hui pour disqualifier
des catégories entières de la population qui seraient indignes
de fréquenter l’école. L’absentéisme peut faire l’objet
d’un signalement, les injures (fréquentes entre automobilistes mais
interdites aux élèves) de même. Sans nier les situations
de violence ingérables dans certains établissements scolaires
où se retrouvent tout spécialement des catégories
sociales marginalisées et ghettoïsées qui sont en nombre
de plus en plus nombreux, on ne peut user de terme de violence pour qualifier
toute forme de résistance à l’école. Cette extension
ne sert que ceux qui veulent stigmatiser les plus pauvres pour légitimer
leur situation et se dédouaner de l’extension généralisée
de la régression sociale aujourd’hui.
Most